À la une
LIBÉRALISATION DU CAPITAL DES PHARMACIE
.jpg)
market-driven entity.
LIBÉRALISATION DU CAPITAL DES PHARMACIE - RMDDS

Maladie du sommeil - Acoziborole

L’acoziborole représente une avancée thérapeutique importante par rapport aux traitements actuels. Jusqu’à présent, les options disponibles nécessitaient soit dix jours de traitement oral, soit des protocoles plus lourds associant perfusions et médicaments oraux pour les formes avancées. La possibilité d’un traitement en une seule prise de trois comprimés simplifie considérablement la prise en charge, notamment dans des zones rurales où l’accès aux structures de soins est limité.
mCOMBRIAX - COVID- GRIPPE
.jpg)
Rappel des lots

L'Insitut Pasteur Maroc, en accord avec l'Agence marocaine du médicament et des produits de santé (AMMPS), procède au rappel des lots de la spécialité pharmaceutique SERUM ANTITOXINE TETANIQUE 1500 U.I.B.P – solution injectable(DCI : Fragments F(ab')2 d’immunoglobuline antitétanique équine.
Ce rappel de lait fait suite au signalement de cas de résistance à l'ouverture des flacons.
L'AMMPS invite l’ensemble des prescripteurs, pharmaciens hospitaliers et d’officine, ainsi que les établissements pharmaceutiques grossistes-répartiteurs et les établissements de santé, à prendre les dispositions nécessaires et à cesser immédiatement la dispensation, la distribution ou l'utilisation et procéder au retour de tous les lots de cette spécialité pharmaceutique.
Les lots retirés seront remplacés par d’autres dont les flacons garantissent une ouverture facile, sécurisée et conforme aux exigences d’usages.
Autres articles
La libéralisation du capital des pharmacies est aujourd’hui présentée comme un levier de modernisation et d’investissement pour le secteur officinal marocain. En réalité, elle pose une question fondamentale : la pharmacie est-elle un commerce perfectible par la finance ou un établissement de santé de premier recours dont l’indépendance constitue un élément clé pour préserver l’intérêt du patient ? L’expérience européenne montre que l’ouverture du capital transforme profondément le rôle de l’officine. Lorsque des investisseurs entrent dans le capital, la logique financière tend à supplanter la logique de soin. Le pharmacien devient salarié, soumis à des objectifs commerciaux et à des politiques d’achats centralisées. Le temps consacré au conseil s’amenuise, la dispensation a tendance à se standardiser et la relation personnalisée avec le patient s’affaiblit. Cette évolution ne relève pas seulement d’un changement de statut, elle modifie la qualité même de la prise en charge. La financiarisation entraîne également une concentration du réseau. Les chaînes privilégient les zones urbaines rentables et délaissent les territoires moins solvables. Dans les pays qui ont largement ouvert le capital, on observe une densification des officines dans les centres commerciaux et une raréfaction dans les zones rurales. Or, au Maroc, la pharmacie constitue souvent le premier point d’accès aux soins, voire l’unique dans certaines régions. Une telle évolution accentuerait les inégalités territoriales et compromettrait la proximité sanitaire. Les conséquences concernent aussi l’Assurance maladie obligatoire. L’argument selon lequel les chaînes permettraient de réduire les coûts grâce aux économies d’échelle est trompeur. Si certaines optimisations logistiques sont possibles, la logique commerciale favorise l’augmentation des volumes dispensés. La diminution du rôle de régulation du pharmacien indépendant peut conduire à une hausse de la consommation médicamenteuse et, par conséquent, des dépenses prises en charge par les caisses. L’équilibre financier de l’AMO, déjà fragile, pourrait en être affecté. Le contexte marocain rend cette perspective particulièrement risquée. Le réseau officinal est économiquement fragilisé par la baisse des prix des médicaments, l’endettement et le non-respect du circuit légal de distribution. L’ouverture du capital faciliterait le rachat des pharmacies en difficulté par des groupes disposant de moyens financiers importants. En quelques années, le paysage officinal pourrait basculer vers une concentration rapide, avec la disparition des petites officines. Le pharmacien passerait progressivement du statut d’entrepreneur à celui de salarié, qui doit se plier aux exigences des investisseurs. Moderniser la pharmacie marocaine est nécessaire, mais cela ne suppose pas de livrer sa propriété à des logiques financières. Des alternatives existent : mécanismes de financement dédiés, coopératives professionnelles, groupements contrôlés par les pharmaciens, réforme de la rémunération axée sur les services de santé. Ces solutions permettent d’apporter des ressources tout en préservant l’indépendance clinique et le maillage territorial. La propriété professionnelle n’est pas un privilège corporatiste. Elle constitue un outil de régulation sanitaire qui garantit une dispensation guidée par l’intérêt du patient. Ouvrir largement le capital reviendrait à transformer la pharmacie en simple point de distribution, au détriment de sa mission de santé publique. Le choix auquel le Maroc est confronté est donc clair : préserver un réseau de proximité porté par des professionnels de santé indépendants qui doivent améliorer leurs pratiques ou accepter une concentration financière qui pourrait fragiliser l’accès aux soins, alourdir les dépenses de l’AMO et altérer la qualité de la prise en charge des patients. Abstract The liberalization of pharmacy ownership in Morocco is framed as a pathway to modernization and investment, yet it raises fundamental questions about the healthcare role of community pharmacies. European experiences show that opening capital often shifts priorities from patient care to financial performance, leading to pharmacist salarization and standardized dispensing practices. This transformation weakens professional autonomy and reduces personalized counseling. It also accelerates market concentration, favoring profitable urban areas while threatening access to medicines in underserved regions. Increased commercial pressure may drive higher medicine volumes and potentially raise health insurance expenditures. Preserving pharmacist ownership appears crucial to maintaining care quality, territorial equity, and sustainable healthcare spending.
Abderrahim Derraji - 21 février 2026 12:58La financiarisation gagne progressivement le réseau officinal français, portée par l’entrée de fonds d’investissement, des montages d’acquisition sous contrainte et des logiques de concentration territoriale. Ce mouvement, encore diffus, fait peser plusieurs risques : perte d’indépendance professionnelle, inflation des prix de cession, fragilisation de l’accès aux soins et, à terme, déséquilibre du maillage pharmaceutique. Pour Thomas Fatome, directeur général de la Caisse nationale de l'Assurance maladie, il s’agit d’une prise de contrôle de structures de santé par des acteurs extérieurs guidés par un retour sur investissement rapide. L’exemple de la biologie médicale illustre les effets possibles : plus de 4 000 sites de ville en 1980 contre moins de 400 aujourd’hui, concentrés entre quelques groupes, avec des laboratoires transformés en simples centres de prélèvement et une relation médicale appauvrie, comme l’ont souligné les Académie nationale de médecine et l’Académie nationale de pharmacie. Les syndicats redoutent une évolution comparable pour l’officine, structurée non plus par les besoins de santé mais par des impératifs de rendement. Le secteur attire les investisseurs en raison d’une rentabilité élevée et de la solvabilité de la dépense publique. Dans la biologie, le taux de rentabilité atteignait 13,9 % en 2023 selon un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale des finances. Comme le rappelle Guillaume Racle de l’Union des syndicats de pharmaciens d'officine, ces acteurs poursuivent avant tout un objectif de profit. Dans l’officine, la financiarisation passe surtout par l’endettement. Des investisseurs imposent des business plans contraignants, des fournisseurs ou des objectifs de performance, parfois jusqu’à contrôler les flux financiers, reléguant le titulaire à un rôle de gérant opérationnel, selon l’avocat Guillaume Marquis. Certaines clauses ont été annulées par le Tribunal judiciaire de Paris en janvier 2026 au nom de l’indépendance professionnelle. Le phénomène reste difficile à quantifier faute d’outils de suivi, mais Julien Chauvin de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France alerte sur un possible basculement si 20 à 30 % du réseau passaient sous influence financière. Les acquisitions ciblent surtout les officines à fort chiffre d’affaires, notamment celles dispensant des médicaments coûteux, ce qui gonfle artificiellement les valorisations et alimente un cercle spéculatif. Malgré un cadre juridique protecteur — propriété réservée aux pharmaciens et contrôle du capital — des montages contractuels complexes contournent partiellement les règles. La Commission des affaires sociales du Sénat préconise de renforcer les moyens de contrôle et de lever les clauses de confidentialité qui limitent l’accès de l’Ordre national des pharmaciens aux contrats. Au-delà des aspects financiers, l’enjeu est territorial : regroupements, méga-officines périphériques et désertification de certaines zones pourraient remodeler la géographie pharmaceutique. La profession appelle donc à une vigilance précoce pour préserver l’indépendance des titulaires et l’équilibre du maillage officinal.
Abderrahim Derraji - 21 février 2026 12:51En 2025, le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a enregistré un bénéfice annuel de 10,23 milliards de dollars, en forte hausse de 45% par rapport à l’année précédente, porté principalement par ses médicaments anticancéreux. Cette performance reflète des résultats solides dans l’ensemble de ses domaines thérapeutiques, selon son directeur général Pascal Soriot, qui souligne également l’expansion du portefeuille de produits du groupe. Le chiffre d’affaires global a progressé de 9%, atteignant 58,74 milliards de dollars, grâce non seulement aux traitements contre le cancer, mais aussi aux médicaments pour les maladies cardiovasculaires, rénales, métaboliques et les maladies rares. Les États-Unis et les marchés émergents ont particulièrement contribué à cette croissance, confirmant le rôle majeur de ces territoires dans la stratégie commerciale d’AstraZeneca. Le laboratoire britannique ambitionne de porter son chiffre d’affaires annuel à 80 milliards de dollars d’ici 2030, une cible soutenue par d’importants investissements internationaux. En Chine, AstraZeneca prévoit d’investir 15 milliards de dollars d’ici 2030 pour développer sa production et renforcer la recherche et développement. Le groupe a également conclu un accord avec CSPC Pharmaceuticals pour concevoir des traitements de nouvelle génération contre l’obésité et le diabète. Aux États-Unis, son principal marché, AstraZeneca a annoncé un plan d’investissement massif de 50 milliards de dollars d’ici 2030, visant à sécuriser sa production et sa R&D sur le sol américain, dans un contexte de pression politique sur les entreprises pharmaceutiques pour relocaliser leurs activités et réduire les prix des médicaments. En réponse à la politique américaine, notamment sous la présidence de Donald Trump, qui visait à imposer des droits de douane sur les importations pharmaceutiques et à faire baisser les prix, AstraZeneca a accepté de transférer progressivement une partie de sa production européenne aux États-Unis. Le groupe s’est également engagé à réduire le prix de certains médicaments dans le pays, obtenant en contrepartie une exemption de surtaxes douanières pour trois ans. Parallèlement, AstraZeneca a élargi sa présence financière en étant cotée depuis le 2 février 2025 à la Bourse de New York, tout en conservant sa cotation principale à la Bourse de Londres et son siège au Royaume-Uni. Cette double cotation témoigne de sa stratégie de consolidation sur les marchés internationaux, renforçant à la fois sa visibilité et son accès aux capitaux. En résumé, AstraZeneca combine croissance des ventes, diversification thérapeutique et expansion internationale. Sa stratégie repose sur l’innovation, le renforcement de la production locale dans des marchés clés comme les États-Unis et la Chine, et la gestion proactive des pressions réglementaires et commerciales. Ces éléments permettent au laboratoire britannique de consolider sa position mondiale tout en préparant un développement soutenu pour la décennie à venir.
Abderrahim Derraji - 21 février 2026 12:47La Food and Drug Administration (FDA) américaine a accepté la demande d’autorisation de mise sur le marché déposée par Roche pour le giredestrant, une thérapie orale expérimentale, en association avec l’évérolimus, dans le traitement du cancer du sein localement avancé ou métastatique ER-positif, HER2-négatif présentant une mutation ESR1 après échec d’une hormonothérapie. Une décision réglementaire est attendue d’ici le 18 décembre 2026. Si elle est approuvée, cette combinaison pourrait devenir la première association entièrement orale incluant un SERD (dégradeur sélectif du récepteur aux œstrogènes) disponible après traitement par inhibiteurs de CDK4/6. Le feu vert de la FDA découle des résultats de l’essai de phase III evERA Breast Cancer, qui a démontré un bénéfice clinique significatif. L’association giredestrant-évérolimus a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 44% dans la population globale et de 62% chez les patientes porteuses de la mutation ESR1, comparativement à une hormonothérapie standard combinée à l’évérolimus. La survie sans progression (PFS) médiane a atteint 9,99 mois contre 5,45 mois dans la population ESR1 mutée, et 8,77 mois contre 5,49 mois dans la population globale, avec des différences hautement significatives. Les données de survie globale restent immatures mais montrent déjà une tendance favorable dans les deux populations. Sur le plan de la tolérance, le profil de sécurité de la combinaison s’est révélé gérable et conforme aux effets connus des deux médicaments, sans signal inattendu ni nouvel effet indésirable majeur. L’absence de photopsies, effet parfois observé avec certains SERD, est notable. Le cancer du sein ER-positif représente environ 70% des cas, et la résistance aux traitements endocriniens, notamment après inhibiteurs de CDK4/6, constitue un défi majeur associé à un mauvais pronostic. Une stratégie combinant deux mécanismes d’action – dégradation du récepteur aux œstrogènes et inhibition de la voie mTOR – pourrait améliorer le contrôle tumoral tout en offrant l’avantage d’un traitement entièrement oral, réduisant le recours aux injections et l’impact sur la qualité de vie des patientes. L’essai evERA constitue la première étude de phase III positive pour le giredestrant dans la maladie avancée. D’autres données soutiennent son développement, notamment l’étude lidERA dans le cancer du sein précoce et les résultats néoadjuvants de coopERA, qui ont montré une réduction supérieure de la prolifération tumorale par rapport à un inhibiteur de l’aromatase. Roche prévoit de soumettre prochainement les données de lidERA aux autorités sanitaires internationales. Par ailleurs, les résultats de l’étude persevERA, évaluant le giredestrant en première ligne, sont attendus prochainement. L’ensemble de ces résultats suggère que le giredestrant pourrait s’imposer comme une nouvelle option majeure d’hormonothérapie ciblée, tant au stade précoce qu’avancé du cancer du sein ER-positif, en particulier chez les patientes porteuses de mutations ESR1 et en situation de résistance aux traitements standards.
Abderrahim Derraji - 21 février 2026 12:32Alors que de nombreux systèmes de santé confèrent de plus en plus de nouvelles missions au pharmacien d’officine pour renforcer la prévention et la prise en charge des maladies chroniques, la pharmacie marocaine demeure enfermée dans un modèle centré quasi exclusivement sur la dispensation. L’évolution de la pharmacie en Europe s’inscrit parfaitement dans cette dynamique. En effet, dans le cadre du projet Jacardi, une expérimentation sera lancée en octobre 2026 dans les régions françaises des Hauts-de-France et du Grand Est. Cette initiative vise à impliquer les pharmaciens d’officine dans le dépistage de l’hypertension artérielle et la sensibilisation du public. En pratique, toute personne se présentant à l’officine pourra bénéficier d’une prise de tension, se voir proposer un tensiomètre et, en cas de valeur élevée, être orientée vers un médecin ou vers les urgences si nécessaire. L’objectif est clair : améliorer la littératie en santé, repérer précocement les patients à risque et renforcer le suivi des pathologies chroniques, consacrant ainsi le pharmacien comme acteur de premier recours dans la prévention cardiovasculaire. Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large, à l’image de l’implication des pharmaciens dans la vaccination en officine, dont l’impact sur la couverture vaccinale et l’accessibilité aux soins a été largement démontré. Lorsqu’on confie au pharmacien des missions cliniques dans un cadre bien défini et structuré, le système de santé gagne en efficacité, en proximité et en capacité de prévention. Le pharmacien devient alors un maillon essentiel du parcours de soins, contribuant à désengorger les structures médicales tout en améliorant le suivi des patients. À l’inverse, au Maroc, la profession évolue peu depuis plus de trois décennies. Malgré une formation scientifique solide et un maillage exceptionnel, le pharmacien reste souvent perçu comme un simple dispensateur de médicaments. Cette situation ne relève pas seulement d’un enjeu professionnel ; elle constitue une perte d’opportunité pour le système de santé, qui se prive d’un levier accessible pour le dépistage précoce, l’éducation thérapeutique et la prévention des maladies chroniques, dont la charge ne cesse de croître. Les discours sur la réforme du système de santé se multiplient, mais la pharmacie demeure en marge de cette évolution. Moderniser la profession ne peut se faire à coups de promesses, mais passe par la reconnaissance de missions cliniques, la mise en place de protocoles, l’adaptation de la formation continue, un cadre de bonnes pratiques et, surtout, un modèle de rémunération valorisant les actes de santé publique. L’expérience internationale montre qu’intégrer pleinement le pharmacien dans la prévention et le suivi des patients n’est pas une option, mais une nécessité stratégique. Le Maroc dispose des compétences et d’un réseau officinal capable de jouer ce rôle. Ce qui manque aujourd’hui, c’est une volonté politique claire, une vision structurée et une meilleure organisation de la profession. Sans cela, la pharmacie continuera d’observer les réformes étrangères à distance, consciente des enjeux mais privée des moyens d’y répondre. Abstract Community pharmacy worldwide is expanding toward preventive and clinical services, yet Moroccan pharmacy practice remains largely dispensing-focused. European initiatives, such as the JACARDI pilot in the Hauts-de-France and Grand Est regions, illustrate the growing role of pharmacists in hypertension screening, patient education, and referral pathways. Evidence from vaccination and chronic disease programs shows that structured clinical tasks improve access, health literacy, and system efficiency. In Morocco, despite strong training and dense pharmacy coverage, pharmacists remain underutilized in prevention and therapeutic education. Integrating clinical missions, protocols, continuing education, and remuneration for public health services is a strategic necessity to optimize care pathways and address the rising burden of chronic diseases. #PharmacieOfficinale #PréventionSanté #DépistageHTA #MaladiesChroniques #RôleDuPharmacien
Abderrahim Derraji - 16 février 2026 10:40Une nouvelle étude de cohorte publiée dans le JAMA suggère qu’une consommation régulière et modérée de café et de thé est associée à une baisse du risque de démence ainsi qu’à de modestes améliorations des performances cognitives, indépendamment de la prédisposition génétique, notamment du génotype APOE4 et des scores polygéniques de risque de maladie d’Alzheimer. Les données utilisées proviennent de deux grandes cohortes américaines totalisant plus de 130 000 participants suivis durant une période pouvant atteindre 43 ans. Au cours du suivi, 11 033 cas de démence ont été recensés. Les résultats révèlent que la consommation d’environ deux à trois tasses de café (caféiné) par jour est associée à une réduction de 18 % du risque de démence, tandis qu’une consommation d’une à deux tasses de thé par jour est liée à une diminution du risque de 16 %. En revanche, le café décaféiné n’a été associé à aucune baisse du risque de démence. Ces observations suggèrent un rôle potentiel de la caféine, même si les auteurs rappellent que le café et le thé contiennent également de nombreux composés comme les polyphénols et l’acide chlorogénique, susceptibles de réduire le stress oxydatif, d’améliorer la fonction vasculaire et de limiter les lésions cérébrales. Les auteurs de l’étude indiquent que les consommateurs de café décaféiné peuvent présenter des caractéristiques de santé particulières qui compliquent l’interprétation des résultats. L’étude met en évidence une diminution du déclin cognitif subjectif chez les consommateurs modérés de café et de thé, ainsi que de légères améliorations des scores cognitifs objectifs. L’écart observé entre les plus forts et les plus faibles consommateurs de café correspond à environ 0,6 année de vieillissement cognitif en moins, un effet modeste au niveau individuel mais potentiellement significatif à l’échelle de la population. Les bénéfices semblent surtout présents avant l’âge de 75 ans, sans effet supplémentaire au-delà d’une consommation modérée. Les auteurs insistent sur le fait que ces résultats doivent être interprétés avec prudence en raison du caractère observationnel de l’étude, de l’absence d’informations détaillées sur les types de thé et les modes de préparation du café, ainsi que d’une population majoritairement composée de professionnels de santé blancs, ce qui limite la généralisation des conclusions. Les auteurs soulignent que la consommation modérée de café ou de thé peut s’inscrire dans une stratégie globale de prévention incluant l’activité physique, le contrôle des facteurs de risque vasculaires, la qualité du sommeil et une alimentation équilibrée. Des experts indépendants rappellent que les bénéfices observés pourraient également refléter des habitudes de vie plus favorables chez les consommateurs de caféine et appellent à poursuivre les recherches pour mieux comprendre les mécanismes impliqués.
Abderrahim Derraji - 16 février 2026 10:34Le président américain Donald Trump a annoncé le lancement d’un site Internet baptisé TrumpRx.gov, destiné à permettre aux Américains d’accéder à des médicaments à prix fortement réduits. Cette initiative s’inscrit dans un contexte de mécontentement croissant de la population face au coût de la vie et, en particulier, aux dépenses de santé, qui sont les plus élevées au monde. D’après les données de l’OCDE, un Américain dépense en moyenne plus du double des ressortissants des autres pays riches pour ses soins médicaux. Le nouveau portail ne permet pas l’achat direct de médicaments en ligne. Il propose plutôt des bons de réduction que les patients peuvent présenter en pharmacie afin de bénéficier de tarifs négociés. Donald Trump affirme avoir conclu un accord avec une dizaine de laboratoires pharmaceutiques, permettant des baisses de prix pouvant atteindre 80 % sur des dizaines de traitements couramment prescrits. L’objectif affiché est de rendre les médicaments plus accessibles aux États-Unis et de répondre à une critique récurrente des patients, qui doivent souvent payer leurs traitements plus cher que dans d’autres pays. Lors de la présentation du dispositif, le président a pris l’exemple de l’antidiabétique Ozempic, dont le prix passerait de 1 000 à 199 dollars grâce à ce programme. Il a également encouragé les patients à vérifier systématiquement la disponibilité de leurs traitements sur la plateforme avant tout achat afin de profiter des tarifs négociés. Mehmet Oz, responsable du programme public d’assurance maladie, a soutenu cette démarche en soulignant son potentiel pour réduire la charge financière des patients. Cette initiative revêt aussi une dimension politique. Elle intervient alors que le camp présidentiel s’inquiète des répercussions électorales du mécontentement lié au pouvoir d’achat, à l’approche des élections de mi-mandat prévues fin 2026. Le coût des médicaments constitue en effet un sujet majeur de préoccupation pour de nombreux Américains. En mettant en avant l’idée que les consommateurs américains subventionnent indirectement les prix plus bas pratiqués dans d’autres pays, Donald Trump cherche à renforcer son argumentaire en faveur d’une réforme des prix du médicament. Reste à savoir si ce dispositif, fondé sur des accords volontaires avec l’industrie pharmaceutique et reposant sur un système de coupons, permettra réellement de réduire durablement les dépenses de santé des patients et d’améliorer l’accès aux traitements.
Abderrahim Derraji - 16 février 2026 10:32Les ventes de médicaments psychotropes connaissent une progression marquée en France, notamment chez les moins de 40 ans et plus particulièrement chez les jeunes femmes. Selon Le Parisien (11 février 2026), certaines molécules comme la quétiapine, la fluoxétine ou la sertraline ont enregistré une hausse de plus de 50 % en cinq ans. Cette consommation traduit une augmentation préoccupante des troubles anxieux et dépressifs dans la population, avec une dégradation globale de la santé mentale et une recrudescence des idées et tentatives suicidaires. Cette évolution s’inscrit dans un contexte post-pandémique marqué par l’isolement social, la précarité, les difficultés professionnelles et une pression accrue chez les jeunes adultes. Les femmes sont plus touchées que les hommes avec une prévalence plus élevée des troubles anxiodépressifs mais aussi une meilleure propension à consulter et à recourir aux soins. Les prescriptions d’antidépresseurs et d’antipsychotiques atypiques progressent ainsi de manière continue, témoignant à la fois d’un meilleur repérage des troubles et d’un recours plus fréquent au traitement médicamenteux. Pour les professionnels de santé, cette hausse pose plusieurs enjeux. D’une part, elle souligne la nécessité de renforcer l’offre de soins en santé mentale, notamment l’accès à la psychothérapie et à la prise en charge précoce des troubles. D’autre part, elle interroge sur le risque de médicalisation croissante de la souffrance psychique, en particulier chez les jeunes, et sur la durée parfois prolongée des traitements. Cette augmentation de la demande intervient par ailleurs dans un contexte de tensions d’approvisionnement touchant certaines spécialités psychotropes, ce qui complique la continuité des traitements et peut fragiliser des patients déjà vulnérables. La situation met en évidence la nécessité d’anticiper les besoins, de sécuriser les circuits d’approvisionnement et de promouvoir des stratégies de prise en charge globales associant traitement médicamenteux, suivi psychologique et mesures de prévention. Au-delà des chiffres, cette tendance constitue un signal d’alerte sur l’état de la santé mentale en France et rappelle l’importance d’une politique publique coordonnée, axée à la fois sur l’accès aux soins, la prévention et la déstigmatisation des troubles psychiques.
Abderrahim Derraji - 16 février 2026 10:27Au Maroc, le droit à l’information est consacré par l’article 27 de la Constitution et encadré par la loi n° 31-13 relative au droit d’accès à l’information, adoptée le 22 février 2018 et publiée au Bulletin officiel le 12 mars de la même année. Ce texte fondateur s’inscrit dans la droite ligne des engagements internationaux du Royaume et traduit sa volonté de se conformer aux standards universels en matière de transparence et de gouvernance, notamment ceux consacrés par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que l’article 10 de la Convention des Nations unies contre la corruption. La loi 31-13 reconnaît explicitement aux citoyens marocains, ainsi qu’aux étrangers résidant légalement sur le territoire national, le droit d’accéder aux informations détenues par les administrations publiques, les institutions élues et les organismes investis d’une mission de service public. Au-delà de son caractère juridique, ce droit poursuit un objectif éminemment démocratique : améliorer l’accès aux services publics, permettre un meilleur suivi des politiques publiques et renforcer durablement la transparence, la redevabilité et l’ouverture des institutions. Dans cet esprit, la loi impose aux organismes concernés une publication proactive du maximum d’informations, par tous les moyens disponibles, notamment électroniques, y compris via les portails nationaux de données publiques. Lorsque l’information n’est pas rendue publique spontanément, le citoyen conserve la faculté d’en faire la demande formelle auprès de l’institution détentrice. Afin de faciliter l’exercice effectif de ce droit, un portail national de transparence a été mis en place. Initialement accessible via chafafiya.ma, il est désormais opérationnel à l’adresse www.pndai.ma, avec pour vocation de dématérialiser les demandes d’information et de centraliser les données publiées de manière proactive. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’action de la jeune Agence marocaine du médicament et des produits de santé. Héritant de solutions conçues à l’époque de la DMP, l’Agence s’est engagée dans un chantier ambitieux visant à moderniser ses outils numériques et à faciliter l’accès à l’information relative aux médicaments, aux produits de santé, aux services assurés et aux différents acteurs du secteur. Malgré un déploiement progressif, exigeant des ressources humaines importantes et un travail de fond considérable, l’Agence vient de franchir une étape majeure avec la mise en ligne d’un projet de Répertoire national des médicaments génériques, qui se veut un levier pour un meilleur usage du médicament. Et l’élan ne s’arrête pas là. Selon une correspondance adressée aux établissements pharmaceutiques industriels2 l’Agence se prépare à publier les Résumés des Caractéristiques du Produit (RCP), en commençant par ceux des princeps. Une avancée majeure, presque révolutionnaire, dictée par une exigence de transparence qui n’est désormais plus un slogan, mais une réalité en construction au Royaume. Les RCP constituent en effet une référence réglementaire essentielle pour la prescription et la dispensation, fondée sur des données validées lors de l’enregistrement. Leur publication officielle permettra de garantir la sécurité et le bon usage des médicaments, tout en offrant aux professionnels de santé une information fiable, scientifique et juridiquement opposable. Jusqu’à présent, ces documents n’étaient accessibles qu’à travers des sources étrangères, parfois inadaptées au contexte national, avec des divergences notables d’un pays à l’autre pour un même médicament. La publication de RCP marocains mettra fin à ces incohérences et répondra à une attente forte des professionnels de santé, ainsi que des développeurs de solutions informatiques. L’initiative de l’Agence marocaine du médicament s’inscrit donc dans une dynamique louable. Si elle s’accompagne d’une maintenance scientifique rigoureuse, d’un dialogue constant avec les acteurs du terrain et d’une publication régulière des mises à jour, elle pourrait positionner le Maroc comme un exemple régional en matière d’accessibilité à l’information pharmaceutique au service du patient. Dans le cas contraire, les professionnels de santé risqueraient de passer à côté de modifications importantes, tandis que les développeurs de logiciels et d’applications de santé continueraient de perdre un temps précieux — un temps qui pourrait être consacré à concevoir des outils innovants au service des soignants et, in fine, à l’amélioration de la prise en charge des patients. Sources : 1 : Loi n° 31-13 : lien 2 : Circulaire n° 63 EAM/AMMPS/26 du 2.FEV.2026 ABSTRACT: This article examines the constitutional and legal foundations of the right to access information in Morocco, with a particular focus on the pharmaceutical sector. It highlights the role of Law No. 31-13 in promoting transparency, accountability, and improved public service governance. Special attention is given to the initiatives of the Moroccan Agency for Medicines and Health Products to enhance access to reliable regulatory information. The forthcoming publication of national Summaries of Product Characteristics (SmPCs) is presented as a major step toward ensuring safe and appropriate use of medicines. Overall, the article argues that transparency in pharmaceutical information is becoming a concrete and irreversible public policy priority in Morocco.
Abderrahim Derraji - 07 février 2026 10:57Le Parlement européen a franchi une étape majeure dans la lutte contre les pénuries de médicaments en adoptant, le 20 janvier dernier, un ensemble de propositions visant à renforcer la disponibilité et la sécurité d’approvisionnement des médicaments critiques au sein de l’Union européenne. Adopté à une large majorité, ce règlement traduit une prise de conscience collective face à la multiplication des ruptures de stocks observées ces dernières années, y compris pour des médicaments essentiels dont l’absence peut entraîner des conséquences graves pour les patients. Bien que l’UE dispose d’une industrie pharmaceutique solide, compétitive et créatrice de près de 800 000 emplois directs, elle reste vulnérable à des perturbations de ses chaînes d’approvisionnement. Ces pénuries trouvent leurs origines dans plusieurs facteurs, notamment la dépendance excessive de l’Union à un nombre restreint de fournisseurs mondiaux pour les principes actifs et les matières premières pharmaceutiques, ainsi que dans des capacités de production insuffisantes sur le territoire européen pour certains médicaments stratégiques. Les fragilités de la chaîne d’approvisionnement, mises en lumière lors de crises récentes, ont souligné la nécessité de repenser le modèle industriel et logistique européen du médicament. Le règlement proposé vise ainsi à créer un cadre structurant pour inverser cette tendance. Il ambitionne de faciliter les investissements dans les capacités de fabrication de médicaments critiques et de leurs intrants clés au sein de l’UE, tout en réduisant le risque de rupture par une diversification accrue et une meilleure résilience des chaînes d’approvisionnement. La mutualisation de la demande entre États membres, via des mécanismes de passation de marchés collaboratifs, constitue également un levier central pour améliorer l’accès équitable aux médicaments d’intérêt commun. Parmi les mesures phares figurent la création de projets stratégiques industriels bénéficiant d’un accès facilité aux financements et de procédures réglementaires et scientifiques accélérées, ainsi que la mise en place d’incitations financières ciblées par les États membres. Le règlement introduit également une évolution importante des règles de marchés publics, en autorisant le recours à des critères autres que le seul prix, afin de privilégier, lorsque cela est justifié, des fournisseurs produisant une part significative des médicaments critiques au sein de l’UE. Un groupe de coordination des médicaments critiques, réunissant la Commission européenne et les États membres, sera chargé d’assurer la mise en œuvre cohérente du dispositif. Enfin, la dimension internationale n’est pas négligée, la Commission est invitée à explorer des partenariats stratégiques avec des pays partageant les mêmes objectifs afin de sécuriser et diversifier davantage les chaînes d’approvisionnement. Pour le rapporteur du texte, Tomislav Sokol, ces propositions traduisent des priorités claires : mieux coordonner les stocks, renforcer la compétitivité de l’industrie pharmaceutique européenne et garantir un accès durable des patients aux médicaments essentiels. Les prochaines étapes passeront par des négociations avec les gouvernements des États membres afin d’aboutir à la version définitive de la législation.
Abderrahim Derraji - 07 février 2026 10:51 Évenements
Évenements


.jpg)
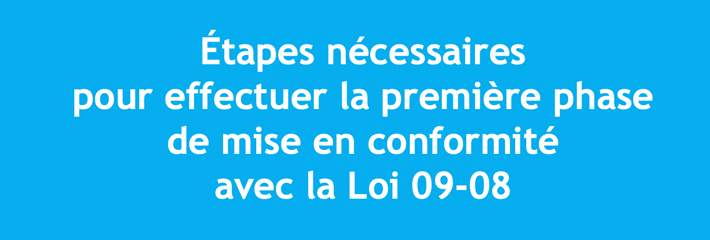
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)










