À la une
RCP - TRANSPARENCE

Pénuries
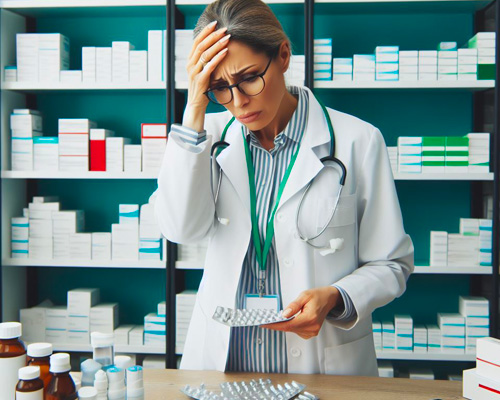
Ces pénuries trouvent leurs origines dans plusieurs facteurs, notamment la dépendance excessive de l’Union à un nombre restreint de fournisseurs mondiaux pour les principes actifs et les matières premières pharmaceutiques, ainsi que dans des capacités de production insuffisantes sur le territoire européen pour certains médicaments stratégiques. Les fragilités de la chaîne d’approvisionnement, mises en lumière lors de crises récentes, ont souligné la nécessité de repenser le modèle industriel et logistique européen du médicament.
Le règlement proposé vise ainsi à créer un cadre structurant pour inverser cette tendance. Il ambitionne de faciliter les investissements dans les capacités de fabrication de médicaments critiques et de leurs intrants clés au sein de l’UE, tout en réduisant le risque de rupture par une diversification accrue et une meilleure résilience des chaînes d’approvisionnement. La mutualisation de la demande entre États membres, via des mécanismes de passation de marchés collaboratifs, constitue également un levier central pour améliorer l’accès équitable aux médicaments d’intérêt commun.
Parmi les mesures phares figurent la création de projets stratégiques industriels bénéficiant d’un accès facilité aux financements et de procédures réglementaires et scientifiques accélérées, ainsi que la mise en place d’incitations financières ciblées par les États membres. Le règlement introduit également une évolution importante des règles de marchés publics, en autorisant le recours à des critères autres que le seul prix, afin de privilégier, lorsque cela est justifié, des fournisseurs produisant une part significative des médicaments critiques au sein de l’UE. Un groupe de coordination des médicaments critiques, réunissant la Commission européenne et les États membres, sera chargé d’assurer la mise en œuvre cohérente du dispositif.
Enfin, la dimension internationale n’est pas négligée, la Commission est invitée à explorer des partenariats stratégiques avec des pays partageant les mêmes objectifs afin de sécuriser et diversifier davantage les chaînes d’approvisionnement. Pour le rapporteur du texte, Tomislav Sokol, ces propositions traduisent des priorités claires : mieux coordonner les stocks, renforcer la compétitivité de l’industrie pharmaceutique européenne et garantir un accès durable des patients aux médicaments essentiels. Les prochaines étapes passeront par des négociations avec les gouvernements des États membres afin d’aboutir à la version définitive de la législation.
MÉDICAMENTS CONSEIL - DÉLISTAGE
.jpg)
Cette proposition s’inscrit dans un contexte de forte tension sur l’accès aux soins, marqué par la désertification médicale qui concerne près de 87 % du territoire français. Dans de nombreuses situations courantes, comme une gastro-entérite aiguë, l’impossibilité de consulter rapidement un médecin retarde la prise en charge, alors même que des traitements symptomatiques efficaces existent mais restent soumis à prescription. Pour NéreS, permettre un accès direct à certains médicaments renforcerait le rôle du pharmacien comme professionnel de santé de premier recours et améliorerait la réactivité du système de soins.
Eli Lilly

OFFICINE EXPO 2026

Autres articles
Rabat, le 29 janvier 2026 – Merck, en collaboration avec son partenaire marocain Cooper Pharma et la Fondation Lalla Salma – Prévention et traitement des cancers, a annoncé le lancement d’un partenariat stratégique visant à améliorer la prise en charge du cancer colorectal et des cancers de la tête et du cou au Maroc. Cette initiative ambitionne de renforcer l’accès aux thérapies innovantes, d’optimiser le diagnostic et d’améliorer la qualité globale des soins oncologiques. Au cœur de cette collaboration figure le renforcement du diagnostic génétique, notamment par le dépistage des mutations de type RAS chez les patients atteints de cancer colorectal. Cet élément est essentiel pour orienter rapidement les décisions thérapeutiques et favoriser une médecine plus personnalisée. Des actions de sensibilisation seront également menées afin de mobiliser les professionnels de santé et les acteurs institutionnels autour de l’importance du diagnostic précoce. Le partenariat prévoit par ailleurs de faciliter l’accès aux thérapies ciblées anti-EGFR pour les patients éligibles pris en charge dans les hôpitaux publics. Cette démarche vise à réduire les disparités d’accès aux traitements innovants et à aligner les pratiques thérapeutiques marocaines sur les standards internationaux. De gauche à droite : M. Ramsey Morad-Régional Vice Président MEAR, Tuekey and CIS-Merck, Dr Latifa El Abida Secrétaire générale de la Fondation Lalla Salma et M. Jaouad Cheikh Lahlou Président fondateur Cooper Pharma Un autre volet majeur concerne la formation médicale continue. Les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge de ces cancers bénéficieront de programmes de formation afin d’améliorer les parcours de soins et d’assurer une prise en charge plus efficace et plus précise des patients. Selon le Registre des cancers du Grand Casablanca, environ 3 817 nouveaux cas de cancer colorectal sont enregistrés chaque année. Ce chiffre illustre l’ampleur du défi auquel est confronté le système de santé marocain et souligne l’urgence de renforcer les capacités de diagnostic et de traitement. Pour Merck, ce partenariat s’inscrit dans une vision de long terme. «Notre engagement va au-delà de l’élargissement de l’accès aux thérapies innovantes. Nous visons également à renforcer les infrastructures de santé et les compétences des professionnels», a déclaré Ramsey Morad, vice-président régional du groupe. L’initiative s’inscrit dans le cadre du programme SHAPE du groupe Merck, dédié à l’amélioration de l’accès aux soins dans les pays à revenu faible et intermédiaire. De son côté, Cooper Pharma a souligné l’importance de cette alliance au service du patient, tandis que la Fondation Lalla Salma, acteur clé de la lutte contre le cancer depuis 2005, réaffirme à travers ce partenariat son rôle central dans la prévention, la sensibilisation et l’amélioration de l’accès aux soins oncologiques au Maroc.
Abderrahim Derraji - 03 février 2026 17:19La ville de Tanger a accueilli, les 23 et 24 janvier, la cinquième édition de MEDEXPO, rendez-vous annuel incontournable organisé par le Groupement d’Intérêt Économique Sigmapharm. Très attendu par ses membres et les acteurs du secteur, l’événement a été placé sous le thème : «Le maintien à domicile : place du pharmacien d’officine dans le parcours de soins». La séance inaugurale a été marquée par l’intervention du Dr Noureddine Salami, président de Sigmapharm, qui a réaffirmé l’engagement du groupement en faveur d’une pharmacie moderne, structurée et pleinement intégrée aux enjeux de santé publique. Il a souligné que l’année 2025 constitue un tournant stratégique pour Sigmapharm, avec la mise en œuvre de deux axes majeurs adoptés en 2024. Le premier concerne la régionalisation du groupement, une réforme ambitieuse visant à rapprocher l’organisation de ses membres, renforcer la gouvernance de proximité et améliorer l’efficacité opérationnelle. Désormais structuré en quatre grandes régions dotées de comités régionaux et locaux, Sigmapharm se veut plus représentatif, plus réactif et plus participatif. Le second axe stratégique porte sur la transformation digitale. Conscient des impératifs de modernisation, le groupement a lancé un vaste chantier de digitalisation, notamment à travers la modernisation de sa plateforme et la signature d’un partenariat stratégique avec Digital4Win, destiné à optimiser la gestion du back-office du groupement et des pharmacies adhérentes. Cette allocution a été suivie par l’intervention du Dr Mounir Tadlaoui, vice-président de la FNSPM, qui a fait le point sur l’avancement des dossiers structurants de la profession. Il a notamment mis l’accent sur les questions sensibles de la rémunération du pharmacien et de l’ouverture du capital des pharmacies, une mesure que pourrait recommander le Conseil de la Concurrence et qui suscite de vives inquiétudes au sein de la profession. De son côté, le Dr Mohamed El Bouhmadi, ancien président de la FMIIP, a exposé les difficultés auxquelles fait face le secteur pharmaceutique, pointant notamment les limites du système actuel de fixation des prix des médicaments et ses répercussions sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Les travaux du congrès ont ensuite mis en lumière le rôle central du pharmacien d’officine dans le parcours de soins, en particulier dans le cadre du maintien à domicile. Cette réflexion s’inscrit dans un contexte démographique marqué par le vieillissement de la population. Au Maroc, près de 14 % des habitants ont plus de 60 ans, une proportion appelée à atteindre 23 % d’ici 2050. Face à la progression des maladies chroniques et de la dépendance, le pharmacien, professionnel de santé de proximité, est appelé à jouer un rôle clé dans la prévention, l’éducation thérapeutique et l’accompagnement des patients âgés. Comme l’a souligné le Dr Salami, «il est temps de conjuguer nos efforts pour bâtir une pharmacie citoyenne, humaine et au cœur du parcours de soins». Enfin, MEDEXPO 2026 a été l’occasion de rendre un vibrant hommage au Dr Mohamed El Bouhmadi, pour son engagement et sa contribution au développement du secteur pharmaceutique national. Docteur en pharmacie et biologiste, diplômé de l’Université de Montpellier, il est actuellement PDG du groupe Zenith Pharma et a occupé plusieurs fonctions clés, notamment celles de président du Conseil de l’Ordre des pharmaciens fabricants et répartiteurs et de président de la Fédération marocaine de l’industrie et de l’innovation pharmaceutique (FMIIP).
Abderrahim Derraji - 03 février 2026 17:10Les vaccins anticancéreux connaissent un essor majeur et sont en train de transformer profondément le paysage de l’oncologie. Longtemps cantonnés à la prévention de certains cancers d’origine virale, ils s’imposent désormais comme de véritables outils thérapeutiques, capables de traiter des tumeurs déjà installées en mobilisant le système immunitaire du patient. Cette évolution marque un changement de paradigme dans la prise en charge du cancer. Les vaccins prophylactiques contre le papillomavirus humain (HPV) et l’hépatite B ont déjà démontré leur efficacité dans la prévention de cancers tels que celui du col de l’utérus, certains cancers ORL ou le cancer du foie. Aujourd’hui, de nouveaux vaccins dits thérapeutiques visent à entraîner le système immunitaire à reconnaître et détruire des cellules tumorales existantes. Des travaux récents, notamment publiés dans The Lancet par des équipes du Mount Sinaï de New York, mettent en lumière ces avancées prometteuses. En situation adjuvante, notamment dans le mélanome et le cancer du pancréas, ces vaccins permettent de réduire la maladie résiduelle minimale et de diminuer le risque de rechute après un traitement initial. Dans des contextes plus avancés, y compris en cas de maladie métastatique, certaines stratégies vaccinales administrées directement au niveau tumoral ont montré des régressions systémiques, y compris dans des cancers du poumon, du sein ou dans certains lymphomes. L’intérêt scientifique est considérable, comme en témoignent les plus de 200 essais cliniques actuellement en cours à travers le monde. Malgré ces avancées, des défis persistent. Certains cancers restent faiblement immunogènes, limitant l’efficacité des vaccins. Des obstacles réglementaires et industriels, notamment liés à la personnalisation et à la production des vaccins à ARNm, devront être surmontés. L’enjeu de l’accès équitable à ces innovations revêt une importance capitale. À l’avenir, le développement de plateformes vaccinales plus puissantes et leur intégration avec les immunothérapies et les thérapies cellulaires pourraient améliorer significativement la survie et la qualité de vie des patients. Les vaccins anticancéreux s’imposent ainsi comme un pilier majeur et en pleine expansion de la lutte contre le cancer.
Abderrahim Derraji - 03 février 2026 17:05Sanofi a annoncé que son médicament expérimental Venglustat a atteint l’ensemble des critères d’évaluation principaux et secondaires dans une étude clinique de phase 3 menée chez des adultes et des adolescents atteints de la maladie de Gaucher de type 3 (MG3). Cette pathologie lysosomale rare se caractérise notamment par des atteintes neurologiques sévères, pour lesquelles il n’existe actuellement aucun traitement approuvé. Les essais cliniques de phase 3 représentent une étape décisive dans le développement d’un médicament, car ils visent à démontrer son efficacité et sa sécurité en comparaison avec les traitements existants ou un placebo, et constituent le dernier jalon avant une éventuelle demande d’autorisation de mise sur le marché. Dans ce contexte, les résultats obtenus par le Venglustat sont particulièrement significatifs. Selon Sanofi, le Venglustat a démontré une supériorité par rapport à l’enzymothérapie substitutive pour le traitement des symptômes neurologiques de la MG3. Cette avancée est majeure, car l’enzymothérapie, bien qu’efficace sur certains aspects de la maladie, n’agit pas sur les manifestations neurologiques, qui représentent un besoin médical non couvert important. Fort de ces résultats positifs, Sanofi prévoit désormais de déposer des dossiers réglementaires à l’échelle mondiale afin d’obtenir une autorisation de commercialisation du Venglustat dans l’indication de la maladie de Gaucher de type 3. En revanche, les résultats sont plus nuancés dans une autre maladie lysosomale rare, la maladie de Fabry. Dans une étude de phase 3 portant sur cette pathologie, le Venglustat n’a pas démontré de supériorité sur le critère d’évaluation principal. Le laboratoire a toutefois indiqué qu’une étude de phase 3 supplémentaire est actuellement en cours, afin d’évaluer plus avant le potentiel du médicament dans cette indication.
Abderrahim Derraji - 03 février 2026 17:02La FDA américaine a accordé la désignation de médicament orphelin à OpCT-001, une thérapie cellulaire expérimentale développée par Bayer et sa filiale BlueRock Therapeutics, pour le traitement de la rétinite pigmentaire (RP). Cette pathologie est l’un des troubles rétiniens héréditaires les plus fréquents et se caractérise par une dégénérescence progressive des cellules photoréceptrices, conduisant à une perte de vision pouvant aller jusqu’à la cécité. La désignation de médicament orphelin vise à encourager le développement de traitements destinés aux maladies rares, en offrant notamment des incitations réglementaires et financières aux laboratoires. Dans ce cadre, OpCT-001 bénéficie d’un soutien renforcé pour poursuivre son développement clinique. OpCT-001 repose sur une approche innovante de thérapie cellulaire, dont l’objectif est de restaurer la vision chez les patients atteints de rétinite pigmentaire en remplaçant les cellules photoréceptrices perdues par de nouvelles cellules fonctionnelles au niveau de la rétine. Cette stratégie pourrait représenter une avancée majeure pour une maladie pour laquelle les options thérapeutiques restent très limitées. Toutefois, OpCT-001 demeure à un stade expérimental. La thérapie n’a encore reçu aucune autorisation de mise sur le marché et son efficacité ainsi que sa sécurité n’ont pas encore été pleinement établies ni évaluées par les autorités réglementaires. Selon Amit Rakhit, directeur médical de BlueRock Therapeutics, OpCT-001 présente un fort potentiel en tant qu’option thérapeutique pour la rétinite pigmentaire et d’autres maladies primaires des photorécepteurs. Bayer et BlueRock ont indiqué leur volonté de poursuivre une collaboration étroite avec la FDA afin de faire progresser le développement clinique de cette thérapie innovante.
Abderrahim Derraji - 03 février 2026 16:59Le 28 janvier 2026, l’Agence marocaine du médicament et des produits de santé (AMMPS) a publié une note d’information en cosmétovigilance alertant sur les risques graves associés à l’utilisation de produits de lissage capillaire contenant de l’acide glyoxylique. Cette alerte s’adresse à la fois aux utilisateurs, aux professionnels de la coiffure et aux professionnels de santé. Selon des données scientifiques internationales, l’acide glyoxylique, qui passe à travers la peau lors du lissage capillaire, peut se transformer dans l’organisme en cristaux. Ces cristaux sont susceptibles de s’accumuler au niveau des reins et d’entraîner des lésions rénales, pouvant évoluer vers une insuffisance rénale aiguë. Ce risque est jugé suffisamment sérieux pour justifier une mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés. Face à ces constats, l’AMMPS recommande aux professionnels de la coiffure de cesser l’utilisation de tout produit de lissage capillaire contenant de l’acide glyoxylique. Les utilisateurs sont, quant à eux, invités à consulter immédiatement un médecin en cas d’apparition de symptômes inhabituels pendant ou après un lissage capillaire. Parmi les signes d’alerte figurent notamment les nausées, une fatigue intense ou des douleurs lombaires, pouvant évoquer une atteinte rénale. L’Agence appelle également les professionnels de santé à une vigilance accrue. Elle les encourage à envisager le lien entre une insuffisance rénale aiguë et l’usage récent de produits de lissage capillaire, et à interroger systématiquement les patients sur ce point en cas de symptômes évoquant une insuffisance rénale aiguë. Enfin, l’AMMPS rappelle l’importance du dispositif national de cosmétovigilance. Tout événement indésirable survenant après l’utilisation d’un médicament, d’un produit cosmétique, y compris les produits de lissage capillaire, doit être déclaré à l’Agence afin de renforcer la surveillance, d’améliorer la sécurité des consommateurs et de prévenir de nouveaux risques sanitaires.
Abderrahim Derraji - 28 janvier 2026 18:43Samedi 17 janvier 2026, Casablanca a accueilli la 26e Journée Pharmaceutique internationale de Casablanca (JPIC), un rendez-vous majeur organisé annuellement par le Syndicat des pharmaciens de la Wilaya du Grand Casablanca. Placée sous le thème «La pharmacie d’officine, entre service de santé et pression économique», cette édition a mis en lumière les enjeux profonds auxquels est aujourd’hui confronté le pharmacien d’officine, appelé à concilier un rôle sanitaire essentiel avec la nécessité de préserver la viabilité économique d’un modèle de plus en plus fragilisé. Dans son discours inaugural, la Dre Ilham Lahlou, présidente du Syndicat des pharmaciens de la Wilaya du Grand Casablanca, a rappelé avec force que le métier de pharmacien dépasse désormais largement la simple dispensation du médicament. Acteur incontournable du parcours de soins, le pharmacien constitue un point d’accès de premier recours pour des millions de Marocains, assurant conseil, orientation et accompagnement au quotidien. Cet engagement de proximité se heurte toutefois à des défis économiques croissants. La pharmacie d’officine fait face à des contraintes conjoncturelles et structurelles lourdes qui menacent l’équilibre de nombreuses officines. La profession est aujourd’hui tiraillée entre sa mission de santé publique et la réalité d’un modèle économique reposant uniquement sur la marge sur les médicaments. Ce modèle a montré ses limites face à une politique de baisse des prix hasardeuse, à l’érosion progressive du monopole officinal, ainsi qu’au non-respect du circuit légal de distribution des médicaments et des produits de santé. Parmi les messages forts portés lors de la séance inaugurale figure la reconnaissance de l’acte pharmaceutique. Il ne s’agit plus uniquement de délivrer un produit, mais d’être reconnu et rémunéré pour la valeur ajoutée professionnelle que représentent le conseil, l’éducation thérapeutique, la prévention et l’orientation des patients. Cette évolution du modèle de rémunération a été largement débattue au cours de la JPIC, avec des appels clairs adressés aux pouvoirs publics afin de mettre en place une rémunération d’actes pharmaceutiques spécifiques. Une telle réforme permettrait à la fois de restaurer la viabilité économique des officines et d’améliorer la qualité des soins de premier recours. Un autre sujet sensible, évoqué avec gravité, concerne la libéralisation du capital des pharmacies et l’indépendance professionnelle du pharmacien. La présidente du Syndicat a rappelé sans ambiguïté la position du Syndicat : la pharmacie doit rester la propriété des pharmaciens. Le fait que la libéralisation du capital ait été évoquée lors d’une réunion du Conseil de la concurrence a suscité une vive inquiétude, dans la mesure où elle pourrait ouvrir la voie à des investisseurs tiers , transformant les officines en actifs financiers davantage orientés vers la rentabilité que vers la santé publique. Pour les pharmaciens, le médicament n’est pas une marchandise comme les autres, et l’indépendance du praticien demeure la seule garantie d’une éthique de santé publique centrée sur le patient. La JPIC 2026 a fait la part belle à l’expérience française, notamment à travers l’intervention du Dr Pierre-Olivier Variot, président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine en France. Son témoignage a mis en évidence les risques liés à la financiarisation du secteur officinal observés dans plusieurs pays européens, et leurs conséquences potentielles sur l’indépendance professionnelle et l’accès aux soins.À cet égard, l’exemple français illustre l’évolution continue de la pratique officinale. Le pharmacien y joue un rôle actif dans la vaccination, le dépistage, la prévention et la prise en charge des maladies chroniques, à travers des missions reconnues et rémunérées, permettant de réduire la dépendance au chiffre d’affaires lié à la vente de médicaments. De son côté, Dre Yasmine Lahlou Filali, présidente de la FMIIP, a rappelé l’importance du rôle du pharmacien d’officine dans le parcours de soins et la nécessité de préserver le maillage officinal, véritable atout pour le système de santé. Outre les sessions de formation continue particulièrement appréciées, le comité d’organisation a programmé une table ronde consacrée au virage numérique, avec un focus sur la feuille de soins électronique (FSE). Plusieurs cadres de la CNSS, dont M. Youssef Fadili, directeur régional, et M. Abderrahim Mrabti, directeur des systèmes d’information, ont présenté la dynamique de transformation numérique engagée par la CNSS ainsi que les aspects pratiques de la dématérialisation des feuilles de soins. Ils ont souligné le rôle central que le pharmacien est appelé à jouer dans la réussite de ce projet et réaffirmé la volonté de la CNSS d’accompagner la profession à travers des actions de sensibilisation et de concertation à l’échelle nationale. Conscients que cette transition ne peut aboutir sans l’implication des éditeurs de logiciels de gestion officinale, les organisateurs de cette Journée ont également donné la parole à M. Houssam Tajjio, Business Manager Pharma et Médical chez Sophatel, qui a exposé les aspects opérationnels de la FSE. En définitive, cette 26e édition de la Journée pharmaceutique internationale de Casablanca a constitué un véritable appel à la réforme. Elle a mis en évidence l’urgence de repenser le modèle économique de l’officine, de structurer et réglementer les missions de santé publique du pharmacien, et d’accompagner les mutations numériques de manière concertée. Bien plus qu’une simple rencontre professionnelle, la JPIC 2026 s’est affirmée comme une tribune pour défendre une vision d’avenir où la pharmacie d’officine demeure un pilier de santé publique, économiquement viable, professionnellement respectée et pleinement engagée au service des patients marocains.
Abderrahim Derraji - 22 janvier 2026 21:45L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM-France) a mis en place des mesures exceptionnelles afin de faire face aux tensions d’approvisionnement touchant les spécialités à base de propranolol dosées à 40 mg. L’Agence française autorise les pharmaciens à remplacer la spécialité à base de propranolol prescrite par une préparation magistrale de gélules, dosées à 20 mg ou 40 mg, tant que cette spécialité est indisponible. Cette substitution peut être réalisée sans qu’une nouvelle ordonnance soit nécessaire, afin de garantir la continuité des traitements pour les patients concernés. Le propranolol est un bêtabloquant classé comme médicament d’intérêt thérapeutique majeur (ITM). L’objectif principal de cette mesure est d’éviter toute rupture de prise en charge, notamment pour des indications sensibles comme certains troubles du rythme cardiaque. L’ANSM encadre strictement ce dispositif par une recommandation officielle et par un arrêté fixant les modalités de facturation des préparations magistrales. La substitution en officine est soumise à plusieurs conditions. Elle n’est possible que si la spécialité prescrite est effectivement indisponible. Le pharmacien doit informer le prescripteur par un moyen sécurisé et expliquer au patient les modalités d’utilisation de la préparation magistrale, en insistant sur le fait que les gélules doivent être avalées entières avec de l’eau. Il doit également indiquer sur l’ordonnance qu’il a procédé au remplacement de la spécialité prescrite par une préparation magistrale. Il doit également mentionner la posologie correspondante.Le conditionnement délivré doit être le plus économique possible pour une durée d’un mois de traitement. En parallèle, ces mesures s’inscrivent dans un ensemble plus large de recommandations adressées aux prescripteurs, visant notamment à limiter les initiations de traitement par propranolol, à réserver son usage à certaines populations prioritaires et, lorsque cela est possible, à privilégier des alternatives thérapeutiques adaptées. L’ANSM précise que ces dispositions sont temporaires et seront levées lorsque l’approvisionnement normal en propranolol 40 mg sera rétabli, certaines autres formes et dosages restant d’ores et déjà disponibles.
Abderrahim Derraji - 22 janvier 2026 21:28Lors de la conférence J.P. Morgan Healthcare qui s’est déroulée le 12 janvier 2026, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a tenu des propos très offensifs à l’égard des pays pratiquant des prix bas du médicament, ciblant explicitement la France. Selon Reuters, il a posé un dilemme provocateur : soit aligner les prix américains sur ceux de la France, soit cesser d’approvisionner cette dernière. Il a affirmé que, dans ce cas, la France se retrouverait sans nouveaux médicaments, estimant que le cadre américain empêcherait Pfizer d’accepter des prix plus faibles à l’international. Ces déclarations ne constituent pas une annonce formelle de retrait, mais relèvent plutôt d’un signal de pression adressé aux pouvoirs publics dans un contexte de négociations internationales fortement influencé par la géopolitique. Cette déclaration s’inscrit dans le prolongement des accords de baisse de prix conclus avec l’administration Trump, qui introduisent un benchmark international des prix, inspiré du principe de «nation la plus favorisée». Un arrêté présidentiel de mai 2025 formalise cette logique, notamment pour certains segments comme Medicaid et pour les lancements de nouveaux médicaments, avec pour objectif de rapprocher les prix américains de ceux observés dans d’autres pays développés. Pour Pfizer, cette politique réduit la capacité du laboratoire à maintenir des écarts de prix entre marchés : si les États-Unis exigent un alignement sur les pays les moins rémunérateurs, l’entreprise affirme n’avoir d’autre choix que de réclamer des hausses ailleurs ou de renoncer à commercialiser certains produits. La France apparaît comme une cible symbolique dans ce bras de fer, en raison de son système de négociation tarifaire strict. Le Financial Times rapporte d’ailleurs que plusieurs groupes pharmaceutiques américains évoquent des retards de lancement, voire des «non-lancements» en Europe, si les conditions économiques ne sont pas jugées satisfaisantes. À ce stade, les propos de Pfizer concernent essentiellement l’accès aux nouveaux médicaments et non le retrait des spécialités déjà commercialisées. Le scénario le plus plausible serait un allongement des négociations de prix et un accès tardif à l’innovation en France. En 2024, le délai médian entre l’AMM et la disponibilité effective atteignait déjà 523 jours, avec de nombreuses indications en négociation prolongée. Un durcissement des rapports de force risquerait de toucher en priorité les domaines où l’innovation est la plus coûteuse, comme l’oncologie. Des dispositifs dérogatoires, tels que l’accès précoce, existent mais restent limités et ne couvrent pas l’ensemble des innovations.
Abderrahim Derraji - 22 janvier 2026 21:16Une application alimentée par l’intelligence artificielle, appelée Zendawa, transforme le fonctionnement des pharmacies de quartier au Kenya, en particulier celles qui opèrent avec de très maigres marges et des outils manuels. Zendawa est utilisée notamment à la Ryche Pharmacy à Nairobi. Avant l’adoption de Zendawa, cette pharmacie perdait régulièrement des médicaments périmés. Grâce à la plateforme, elle surveille automatiquement les dates de péremption et peut écouler les stocks à risque avant qu’ils ne deviennent inutilisables, ce qui a réduit les pertes de près de deux-tiers et augmenté les revenus quotidiens de l’officine. Développée en partenariat avec Microsoft, la solution repose sur Microsoft 365 Copilot et Power BI, mettant l’intelligence artificielle au service de la gestion des stocks, de la prévision des besoins et des rapports en temps réel. Cela permet aux pharmaciens de gérer leur inventaire plus efficacement, d’anticiper la demande et d’optimiser l’espace d’étagère disponible — un enjeu crucial dans un pays où le nombre de pharmaciens par habitant est faible et où les petites pharmacies servent de premier point de contact essentiel pour les soins de santé. Zendawa a aussi créé une plateforme de livraison basée sur l’apprentissage automatique qui associe les commandes aux pharmacies les plus proches disposant des produits, ce qui facilite l’acheminement des médicaments vers les patients. Au-delà de l’inventaire, l’application génère un score de crédit à partir des données de vente et de flux de trésorerie des pharmacies, ouvrant potentiellement l’accès à des financements pour des pharmacies indépendantes qui peinent souvent à obtenir des prêts traditionnels. Selon l’article publié sur news.microsoft.com plus de 800 pharmacies ont déjà adopté Zendawa, améliorant leurs opérations quotidiennes et réduisant le gaspillage des médicaments. En adoptant des outils numériques avancés, ces officines gagnent du temps et peuvent mieux se concentrer sur la prise en charge des patients, tout en renforçant leur durabilité économique.
Abderrahim Derraji - 22 janvier 2026 21:09 Évenements
Évenements


.jpg)
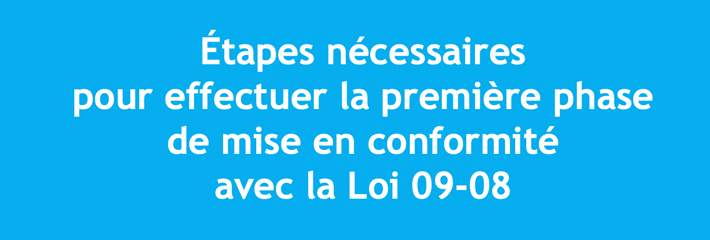
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)









.jpg)