|
[ ÉDITORIAL ]
|
|
QUAND LES SACS EN PLASTIQUE "N'EMBALLENT" PLUS!
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est entrée en vigueur le 19 août dernier. Cette loi signera la fin de l’utilisation des sacs en plastique en France. En effet, les sacs de caisse en matière plastique à usage unique destinés à l’emballage des produits ne pourront plus être ni donnés ni vendus.
De ce fait et à l'instar de tous les commerçants, les pharmaciens français n’auront plus le choix puisqu'ils seront obligés à partir du mois de janvier prochain à utiliser des sacs en papier entièrement biodégradables ou des sacs réutilisables. Les sacs oxo-fragmentables seront également interdits puisque bien qu’ils soient dégradables, ils ne sont pas assimilables par les micro-organismes et non compostables (1).
Cette loi qui va permettre de débarrasser l’environnement de quantité inimaginable de sacs en plastique, va engendrer un surcoût que Les primeurs et fruitiers ont déjà évalué à 300 millions d’euros par an.
En ce qui concerne le Maroc, la consommation des sacs en plastique était en 2003 de 10 525 tonnes par an (2). Un milliard et demi de sacs étaient déposés chaque année dans les décharges. Il est à noter que contrairement à la majorité des autres commerçants, la plupart des pharmaciens utilisent exclusivement des sacs oxo-biodégradables malgré leur prix élevé par rapport au prix des sachets en plastique ordinaire.
Aussi, et sachant que la durée de vie d’un sac en plastique est supérieure à cent ans, les pharmaciens sensibilisés à cette problématique et leurs instances pourraient prendre l’initiative d’étudier des solutions alternatives aux sacs en plastiques en veillant à limiter le surcoût inhérent à leur utilisation. Bien évidemment, les autres commerçants qui utilisent davantage de sacs en plastique, devraient en faire de même, faute de quoi on continuera à détériorer égoïstement l’environnement que nous allons léguer aux générations futures.
Abderrahim DERRAJI
Source : (1) Le Moniteur des Pharmacies (2) : LA VIE ÉCO
|
|
|
Revue de presse

|
 Douze laboratoires marocains en prospection du marché Russe
Douze laboratoires marocains en prospection du marché Russe
Maroc-Export organise, du 13 au 18 septembre à Moscou, une mission de rencontres professionnelles B to B au profit de 12 laboratoires marocains pour le secteur pharmaceutique.
Avec une croissance annuelle moyenne comprise entre 10 et 15%, le marché russe du médicament est l'un des plus dynamiques au monde. Ce marché possède cependant ses propres spécificités. En effet, aujourd'hui, plus de 75% des produits pharmaceutiques sont importés et le marché est caractérisé par la prédominance des produits génériques.
Les perspectives du marché russe sont très encourageantes, des prévisions de croissance supérieures à 5% sont prévues pour les 5 prochaines années.
Le marché russe est une réelle opportunité pour l’industrie pharmaceutique marocaine. Et ce,grâce au niveau de qualité atteint par ses produits pharmaceutiques comme l'atteste l'OMS qui reconnait à l'industrie pharmaceutique marocaine la conformité aux standards internationaux de qualité et place le Maroc dans "la Zone Europe". Les laboratoires qui participent à cette mission sont exportateurs. Ils développent, fabriquent, commercialisent leurs propres médicaments et fabriquent également sous licence pour de grands laboratoires internationaux.
L'industrie pharmaceutique nationale étant classée zone Europe par l'OMS par la qualité de fabrication des médicaments, ses produits sont les bienvenus dans un pays qui compte 170 millions de consommateurs et qui importe 75% de ses médicaments, prédominés par des produits génériques, selon Maroc Export.
La fédération de Russie est le 8ème partenaire commercial du Maroc avec une valeur globale d'environ 22,5 milliards de DHS dont 20,3 milliards de DHS à l'importation de Russie et 2,2 Milliards de DHS à l'exportation par le Maroc.
Source : la Vie Eco
|
|
|
 Rétinopathie diabétique : le dépistage précoce pourrait ne pas être nécessaire
Rétinopathie diabétique : le dépistage précoce pourrait ne pas être nécessaire
Une étude réalisée par des chercheurs américains a révélé que le dépistage annuel précoce de la rétinopathie diabétique chez les enfants diabétiques de type 1 est inutile.
Pour arriver à ce résultat, les scientifiques de l’Université de Pennsylvanie, à Philadelphie, ont analysé les données de 370 diabétiques de type 1 ou 2, âgés de moins de 18 ans. Tous les participants avaient effectué au moins un dépistage de maladie oculaire entre 2009 et 2013, mais aucun n’avait reçu de diagnostic de la maladie.
Les chercheurs ont ensuite évalué les données aboutissant aux directives de dépistage actuelles. Des études ont montré que la prévalence de rétinopathie diabétique chez l’enfant est comprise entre 0 et 28 %. La majorité de ces cas étaient si légers qu’ils ne nécessitaient pas de traitement. Les cas de rétinopathie diabétique les plus graves sont apparus entre 15 et 19 ans, et le délai entre le diagnostic du diabète et l’apparition d’une rétinopathie diabétique grave était au moins de 5 à 6 ans.
Les auteurs de l’étude recommandent donc que les dépistages des enfants diabétiques de type 1 commencent à un âge plus avancé que celui recommandé auparavant. Les dépistages doivent être effectués à partir de l’âge de 15 ans, ou 5 ans après le diagnostic. Des exceptions doivent cependant être faites pour les enfants diabétiques de type 2 et pour les enfants dont les endocrinologues estiment qu’ils sont plus susceptibles de présenter des complications liées au diabète. Ils doivent commencer les dépistages au moment du diagnostic et renouveler les examens chaque année.
Source : Ophthalmology
|
|
|
 La mise en place des implants dentaires doit s’effectuer rapidement en cas d’ostéoporose
La mise en place des implants dentaires doit s’effectuer rapidement en cas d’ostéoporose
Les chercheurs de l’Université Comenius, à Bratislava en Slovaquie, ont étudié les répercussions sur les implants dentaires chez les femmes ménopausées atteintes d’ostéoporose qui étaient traitées aux bisphosphonates.
L’étude a inclus 24 femmes âgées de 54 ans et plus qui avaient perdu la plupart de leurs dents. La moitié des participantes souffrait d’ostéoporose ; l’autre non. Toutes les patientes atteintes d’ostéoporose ont été traitées par un bisphosphonate, l’acide zolédronique, administré par voie intraveineuse une fois par an. Toutes les dents restantes de chacune des participantes à l’étude ont été extraites et immédiatement remplacées par des implants. Un an après l’intervention, l’état des implants a été évalué.
Les résultats ont montré que tous les implants étaient encore intacts. Plusieurs participantes présentaient une certaine perte osseuse, mais dans une mesure similaire dans les deux groupes. Aucun signe d’os nécrosé n’a été observé parmi les patientes traitées à l’acide zolédronique. Toutes les femmes ont démontré un bon contact entre l’os et l’implant.
Les auteurs concluent que le risque d’ostéonécrose de la mâchoire associée aux bisphosphonates chez les patientes souffrant d’ostéoporose est réduit si les implants dentaires sont rapidement mis en place après l’extraction des dents.
Source : Journal of Oral Implantology
|
|
|
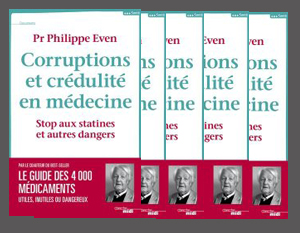 Le livre du Pr Even sème le trouble
Le livre du Pr Even sème le trouble
Le nouveau livre de Philippe Even intitulé « Corruptions et crédulités en médecine. Stop aux statines et autres dangers », a enclenché une grande polémique et fait couler beaucoup d ‘encre.
Ce brûlot contre lequel les acteurs de la santé et du médicament s’insurgent, dénonce des liaisons et dérives entre des médecins et l’industrie pharmaceutique « qui compromettent les finances publiques et la santé des malades ».
Le LEEM, syndicat de l’industrie pharmaceutique, se montre « particulièrement préoccupé par l’extrême gravité de certaines allégations, susceptibles d’alarmer inutilement les malades et de les conduire à arrêter de leur propre chef des traitements pourtant adaptés aux maladies dont ils souffrent ». Inquiet, le LEEM appelle la communauté scientifique à « se saisir des informations contenues dans l’ouvrage (…) et d’en relever, sur des bases objectives et partagées, les mensonges et les approximations ». Il charge par ailleurs le Comité de déontovigilance des entreprises du médicament (CODEEM) d’une « analyse critique, objective et documentée (…) et de se rapprocher des instances déontologiques des professionnels de santé ».
Le LEEM rappelle que Philippe Even est frappé d’une interdiction d’exercer la médecine depuis 2014, tandis que la Société française de cardiologie parle d’« affabulations d’une personne retirée de l’activité médicale depuis vingt ans, énoncées sans argument recevable ni compétence scientifique dans le domaine ». Elle souligne surtout la « mise en danger de la santé de milliers de patients » de la part de ce pneumologue retraité.
Source : www.lequotidiendupharmacien.fr
|
|
|
 Le cerveau est bien moins compartimenté qu'on le pensait
Le cerveau est bien moins compartimenté qu'on le pensait
En analysant avec de nouveaux outils trois cas historiques, des chercheurs suggèrent que le comportement social, le langage et la mémoire ne sont pas traitées dans des zones précises mais dépendent de l’activité coordonnée de différentes régions.
Phineas Gage, contremaître des chemins de fer, a le cerveau transpercé par une barre à mine le 13 septembre 1848, ce qui provoque des dommages du lobe frontal gauche. Malgré la gravité apparente de la blessure, il survit. Cependant, depuis cet accident, « il n’est plus lui-même » et présente des troubles du comportement : de sérieux et attentionné, il devient instable, asocial, irrationnel et incapable de ressentir des émotions. Depuis l’étude de ce cas, les émotions et le contrôle du comportement sont associés au cortex orbito-frontal.
Louis Victor Leborgne perd la capacité de parler à l’âge de 30 ans et ne peut prononcer que la syllabe « tan ». C’est en pratiquant son autopsie que son médecin, Paul Broca, découvre une lésion dans le cortex frontal inférieur gauche, siège de la région cérébrale responsable, baptisée aire de Broca.
Enfin, Henry Molaison devient amnésique à la suite d’une intervention chirurgicale consistant à lui retirer une large portion des deux hippocampes. Il est incapable de mémoriser de nouveaux événements. Ainsi, la mémoire déclarative a été associée avec des structures du lobe temporal médian.
Pour la première fois, Michel Thiebaut de Schotten de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière et ses collaborateurs ont pu explorer les grandes connexions cérébrales qui ont été endommagées chez ces patients célèbres. Ils ont reconstitué leurs lésions et ont cartographié les connexions entre les différentes régions en se référant à un atlas du cerveau humain en trois dimensions.
Les résultats obtenus par une technique d’imagerie des connexions cérébrales (tractographie IRM) dans la reconstitution des cerveaux de ces trois patients, amènent à une révision essentielle de notre compréhension du Phineas Gage. Ils indiquent que les fonctions affectées chez ces trois patients n’étaient probablement pas seulement dues à la lésion initialement rapportée, mais également à l’interruption de certaines connexions cérébrales profondes provoquant des dysfonctionnements cérébraux à distance de la lésion. Le dysfonctionnement du réseau cérébral est donc un dénominateur commun aux désordres cérébraux étudiés.
Ainsi les résultats de cette étude, publiée dans la revue Cerebral Cortex, suggèrent que le comportement social, le langage et la mémoire dépendent de l’activité coordonnée de différentes régions du cerveau plutôt que de zones circonscrites dans les lobes frontaux ou temporaux.
Source : http://www.futura-sciences.com
|
|
|
|









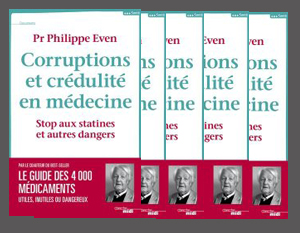

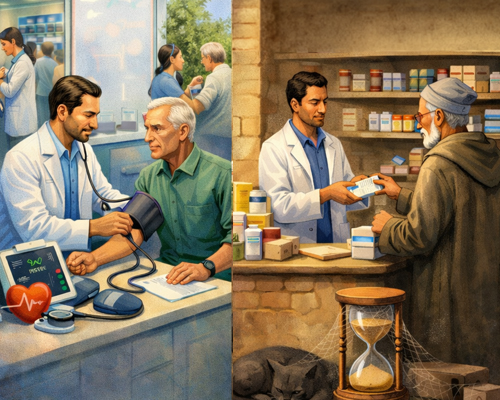
.jpg)
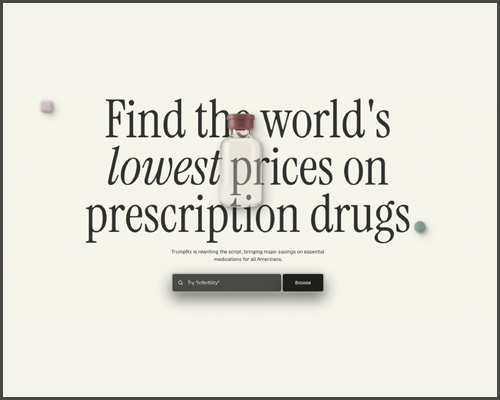
.jpg)