|
[ ÉDITORIAL ]
|
|
Vacances : il vaut mieux prévenir que guérir
La plupart de nos concitoyens attendent la fin du mois de Ramadan pour partir en vacances. Si par le passé, partir en vacances était synonyme d’insouciance et de sécurité, aujourd’hui ce n’est plus le cas. Cette période peut même se transformer en vrai cauchemar, particulièrement quand un événement inattendu vient affecter la santé du voyageur. Pour éviter de tels désagréments, le candidat au voyage doit prendre certaines précautions d’ordre sanitaire en rapport avec la destination choisie.
Pour certains pays, des vaccinations peuvent être exigées avant même l’octroi du visa. C’est le cas des zones intertropicales d'Afrique et d'Amérique du Sud, où le vaccin contre la fièvre jaune doit être administré au moins 10 jours avant le départ. De même, les personnes qui désirent se rendre à la Mecque doivent obligatoirement se faire vacciner contre la méningite.
Pour les personnes qui voyagent dans des régions où l’hygiène peut s’avérer défectueuse, la vaccination contre l’hépatite A et la fièvre typhoïde sont fortement recommandées.
Malheureusement, pour certaines maladies nous ne disposons pas encore de vaccin, c’est le cas de la maladie à virus Zika. Les voyageurs doivent prendre en considération ce nouveau risque sanitaire, d’autant plus qu’il peut être à l’origine de cas de microcéphalie et du syndrome de Guillain-Barré.
Le ministère de la santé marocain a élaboré en début d’année un dépliant qui s’intitule « Comment se protéger contre le virus Zika ? » (1). Par ce support, il a attiré l’attention des voyageurs et particulièrement les femmes enceintes sur la nécessité de suivre certaines recommandations pour éviter d'attraper la maladie à virus Zika. De son côté, l’OMS déconseille aux femmes enceintes de se rendre dans les régions touchées par ce virus (2). Et quand leur conjoint vit ou se rend dans ces zones, elles doivent adopter des pratiques sexuelles à moindre risque ou s’abstenir de toute relation sexuelle pendant toute la durée de la grossesse.
Bien évidemment, ces vaccinations ne peuvent dispenser le voyageur des vaccins classiques prévus par le plan national d’immunisation.
Chez les malades chroniques, un avis favorable du médecin traitant est nécessaire avant toute vaccination. Les précautions à prendre seront en fonction de leur pathologie. Ils doivent ramener avec eux leurs traitements en prévoyant une quantité suffisante pour un mois supplémentaire de traitement. Une ordonnance rédigée en anglais avec une prescription en DCI peut, dans certains cas, s’avérer utile.
Le transport des médicaments thermolabiles nécessite à son tour une attention particulière sans oublier que la congélation comme la chaleur peuvent altérer la qualité de certains médicaments.
Pour conclure, le rôle du professionnel de santé est capital aussi bien pour informer les voyageurs qui s’apprêtent à partir en vacances que pour ceux qui choisissent notre pays pour y passer leurs vacances.
Abderrahim DERRAJI
(1) http://pharmacie.ma/uploads/pdfs/circulaire-MS-Maladie-virus-Zika.pdf
(2) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/fr/
|
|
|
Revue de presse

|
 Médecins spécialistes : un texte de loi durcit les conditions de la démission
Médecins spécialistes : un texte de loi durcit les conditions de la démission
Le projet de décret 2-15-990 modifiant et complétant le décret 2-91-527 relatif à la situation des étudiants externes et internes et des résidents des CHU, stipule que pour pouvoir quitter leur poste, les médecins spécialistes devront attendre au moins huit années.
Ce texte, adopté récemment en Conseil du gouvernement, durcit en effet les conditions de démission des médecins spécialistes, puisque ceux qui sont formés aux frais de l’État n’auront pas le droit de mettre fin à l’engagement sans l’accord du ministère de la Santé.
De plus, la démission ne sera acceptée qu’en cas d’empêchement légal, à condition de restituer les frais de formation dont ils ont bénéficié. Selon le gouvernement, le texte vise à encourager les résidents contractuels avec le ministère à travailler dans des établissements sanitaires en manque d’effectifs et dont la liste sera arrêtée plus tard.
Source : www.leconomiste.ma
|
|
|
 L’académie de médecine appelle à une recherche médicale en fonction des sexes.
L’académie de médecine appelle à une recherche médicale en fonction des sexes.
L’Académie de médecine française a publié un plaidoyer en faveur d’une approche différenciée de la recherche fondamentale et clinique et de la pratique médicale selon les sexes.
Les membres de l’académie jugent qu’au regard des évolutions de la recherche génétiques, il faut passer à une médecine sexuée incluant une conception et une interprétation des études sur l’Homme (et l’animal) qui tiennent compte du sexe.
Cette approche induit la reconnaissance des différences liées au sexe qui déterminent la prévalence, l’âge d’apparition, la sévérité et l’évolution de nombreuses maladies, y compris les réponses aux médicaments et aux régimes. « Mieux comprendre les mécanismes de régulation spécifique du sexe est indispensable pour mieux adapter la prévention, le diagnostic et les traitements », déclarent les académiciens.
Ces derniers estiment que prendre en compte ces spécificités permettrait d’éviter de nombreuses erreurs.
Source : www.lequotidiendupharmacien.fr
|
|
|
 Quelles alternatives aux antibiotiques ?
Quelles alternatives aux antibiotiques ?
La semaine passée cinq Académies françaises (Agriculture, Chirurgie Dentaire, Médecine, Pharmacie et Vétérinaire) ont envisagé les alternatives futures possibles dans un monde où les antibiotiques verraient leur force de frappe amoindrie.
Parmi les alternatives les plus intéressantes, il y a la phagothérapie. Elle correspond au traitement des infections bactériennes par des virus appelés «bactériophages» ou «phages». Leur atout majeur est leur spécificité d'action plus grande que celle des antibiotiques: un phage ne détruit qu'une seule souche bactérienne.
En Europe, l'utilisation des bactériophages est inexistante en raison de l'absence d'autorisation de mise sur le marché. Mais, un essai clinique visant à évaluer l'efficacité de la phagothérapie a été lancé en septembre 2015 dans 11 centres de grands brulés en France, en Suisse et en Belgique.
Les plantes, les insectes et les vertébrés produisent des molécules appelées «peptides antimicrobiens» pour se protéger des infections par les bactéries, les champignons et les virus. Chez les mammifères, ces molécules de défense sont essentiellement produites par certaines cellules de la peau. Une fois libérée, elles peuvent rompre les membranes des microbes ou séquestrer leur nourriture afin de les affamer. Elles ont la particularité de tuer préférentiellement les cellules microbiennes pathogènes, ce qui a l'avantage de ne pas affecter la flore intestinale. Les peptides antimicrobiens sont de bons candidats potentiels à la lutte contre la résistance aux antibiotiques.
La troisième alternative aux antibiotiques va exploiter la propriété qu’ont certaines espèces bactériennes de s'attaquer à leurs congénères. En 2011, une étude menée à l'Université de Nottingham (Royaume-Uni) a montré qu'une bactérie prédatrice, Bdellovibrio, pouvait dévorer des bactéries nuisibles à l'intérieur d'un animal vivant (en l'occurrence des poulets), et cela sans nuire à leur croissance ni à leur santé. Plus récemment, en 2013, des chercheurs ont montré que deux espèces de bactéries prédatrices pouvaient être utilisées pour traiter des infections oculaires bactériennes. Ce cannibalisme, connu depuis les années 1960, fait l'objet d'un regain d'intérêt avec l'émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques.
Les adjuvants aux antibiotiques peuvent être utilisées pour prolonger la vie des antibiotiques existants. Ces adjuvants éliminent les mécanismes de défense que les bactéries développent vis-à-vis des antibiotiques.
La dernière alternative, très prometteuse, est le «Crispr-Cas9». C’est une technologie qui permet de remodeler à loisir de l'ADN. Elle permet de supprimer, modifier ou remplacer un ou plusieurs gènes directement dans une cellule ou un organisme avec une précision inégalée. Cette technologie a donné l'idée à un jeune chercheur de l'Institut Pasteur, David Bikard, de l'utiliser afin de cibler spécifiquement les bactéries porteuses des gènes de résistance aux antibiotiques.
Source : http://sante.lefigaro.fr
|
|
|
 Un bioverre pour régénérer de l'os humain
Un bioverre pour régénérer de l'os humain
L'usage d'un «bioverre» dans des opérations de la colonne vertébrale qui nécessitent une greffe osseuse est prometteur. «Nous utilisons cette céramique pour stimuler la repousse osseuse entre trois et six mois», indique le Pr Cédric Barrey, chirurgien à l'hôpital Pierre Wertheimer, à Bron, près de Lyon. Et d'ajouter: «Nous avons réalisé 80 opérations depuis le début de 2015. Les premiers résultats sont de très bonne qualité. Mais ils demandent à être confirmés dans le temps.
Pour remplacer deux disques intervertébraux endommagés, le chirurgien dépose à la place un mélange, mouillé avec du sérum physiologique, composé d'os du patient et de 36 grammes de «bioverre», qui se présente sous «la forme de granules ».
Ce matériau synthétique aurait une meilleure résorption que les substituts osseux traditionnels, tels les composés dits «phospho-calciques», qui restent «un an après l'opération, ce qui n'est pas optimal pour la consolidation», ajoute le Pr Barrey. En revanche, les éléments du «bioverre» (silicium, calcium, sodium et phosphore) sont «digérés» par l'organisme. Et, selon de premiers résultats scientifiques, la libération d'ions silicium stimule la production et la prolifération de cellules souches par l'organisme et leur différenciation en ostéoblastes.
Source : http://sante.lefigaro.fr
|
|
|
 Après la mort, des gènes "zombies" se réactivent
Après la mort, des gènes "zombies" se réactivent
Une étude parue dans la revue Science a révélé que certains gènes restent en activité quelques jours après la mort chez les souris et les poissons zèbres.
Initialement, des chercheurs de l'Université de Washington (États-Unis), ont voulu tester une nouvelle méthode mise au point pour calibrer les mesures de l'activité des gènes. La technique consiste en la mesure de la quantité d'ARN messager. Une hausse d'ARN messager signifie une plus grande activité des gènes.
Les chercheurs ont procédé à des mesures dans le cerveau et le foie de 548 poissons zèbres et 515 souris. " Ils ont découvert que l'activité de centaines de gènes s'accélérait dans les 24 heures suivant le décès de l'animal, chez les poissons certains gènes sont même restés actifs quatre jour après", raconte Science. Parmi ces gènes qui s'activent après la mort, nombreux sont ceux qui sont bénéfiques en cas d'urgence : ils stimulent l'inflammation, déclenchent le système immunitaire ou aident l'organisme à lutter contre le stress. D'autres ont un rôle plus surprenant. "C'est incroyable de voir des gènes de développement s'activer après la mort", commente Peter Noble dans Science. Des gènes qui servent à sculpter l'embryon mais qui ne sont pas nécessaires après la naissance. Pourquoi donc s'activeraient-ils ? Les auteurs avancent une hypothèse surprenante : "les conditions cellulaires des cadavres "récents" ressemblent à celles des embryons"... Autre constat étonnant : la hausse d'activité de plusieurs gènes favorisant le cancer après le décès. "Ce résultat pourrait expliquer pourquoi les gens qui reçoivent des transplantations d'une personne décédée depuis peu ont un risque plus élevé de cancer", précise Peter Noble.
Selon les auteurs de l’étude, il y aurait des indices indiquant que ces mêmes gènes sont également actifs pendant un certain temps chez les humains décédés. Cela les amène à penser que leur méthode peut être utilisée pour fournir une estimation précise du moment de la mort d’un individu et pour prédire la qualité d'une greffe.
Source : http://www.sciencesetavenir.fr
|
|
|
|











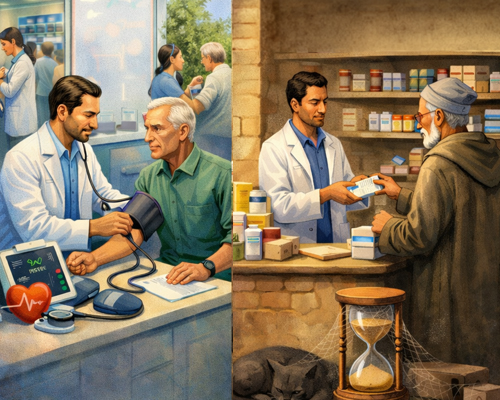
.jpg)
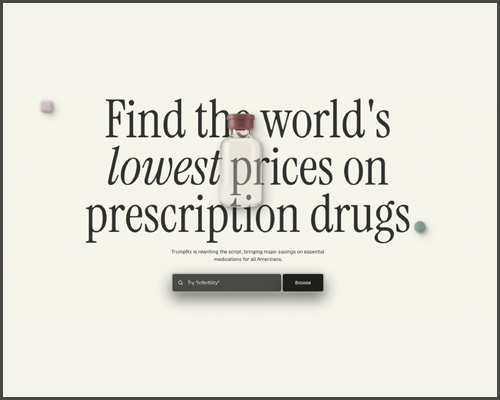
.jpg)