|
[ ÉDITORIAL ]
|
|
Sacs en plastique : nos enfants nous remercieront...
La loi 77-15 interdisant la fabrication, l’importation, l’exportation, la commercialisation et l’utilisation des sacs en plastique, publiée le 14 décembre 2015, entrera en vigueur en juillet 2016, c’est à dire dans une semaine.
Cette mesure qui est à saluer, concerne tous les sacs en plastique à l’exception de ceux destinés aux secteurs agricole et industriel ainsi qu’à la collecte des déchets ménagers. Les sacs isothermes et ceux destinés à la congélation et surgélation jouissent également d’une dérogation.
Pour rendre cette nouvelle loi dissuasive, le législateur a prévu des amendes pouvant atteindre un million de DH.
En effet, l’article 9 de la loi 77-15 punit toute personne se rendant coupable de fabrication de sacs en plastique d’une amende de 200000 DH à 1 million de DH. Quant à l’article 10 de la même loi, il sanctionne tout détenteur en vue de vente ou de distribution (onéreuse ou gratuite) de sachets en plastique d’une amende dont le montant varie entre 10000 et 500000 DH. ?Une amende de 20000 à 100000 DH est également prévue pour toute personne qui détournerait l’usage des sacs en matière plastique.
Cette décision met ainsi fin à un déni collectif vis à vis de l’usage des sachets en plastique qui a affecté irrémédiablement notre environnement. Le chiffre de 900 sachets par habitant fait du marocain le deuxième consommateur de sachet en plastique au monde!
Les pharmaciens, qui font appel aux sachets en plastique à chaque dispensation de médicaments, sont également concernés par cette loi. Le recours à ces sachets, malgré la disponibilité des sachets en papier, s’explique surtout par leur coût et par leur solidité. Les sachets en papier sont fragiles ce qui les rend presque inutilisables pour les sirops et les ampoules buvables. Mais ces inconvénients et les sacrifices à faire ne sont rien devant le plaisir de retrouver une nature dépouillée d’autant de sacs en plastique.
Ce qui est étonnant, par contre, c’est qu’à une semaine de la mise en application de la loi 77-15, la majorité des pharmaciens n’ont pas encore reçu de courrier les informant de leurs obligations, des risques qu’ils encourent y compris en utilisant des sachets biodégradables et des éventuelles alternatives envisageables.
Abderrahim DERRAJI
|
|
|
Revue de presse

|
 Le Roi lance un programme socio-médical
Le Roi lance un programme socio-médical
Le roi Mohammed VI a procédé, samedi à l'arrondissement Sidi Othmane, dans la préfecture Moulay Rachid, au lancement du programme socio-médical de proximité pour la région de Casablanca-Settat (2016-2020).
Initié par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, ce programme régional ambitionne l’amélioration et le renforcement des infrastructures médicales au niveau de la région, via la construction de huit établissements médico-sociaux et de quatre établissements de soins de santé primaire. Il s’agit de trois centres de santé de niveau 1 à Ain Chock, Casablanca-Anfa et Sidi Bernoussi, d’un centre de santé de niveau 2 à Moulay Rachid et de deux centres d’addictologie à Nouaceur et Sidi Bernoussi, et de deux centres médico-psycho-social à Sidi Bernoussi et Moulay Rachid.
Il est également question de la construction d’un centre de rééducation et de réadaptation à Ain Chock, d’un centre de réhabilitation psycho-social au CHU Ibn Rochd, d’un espace santé jeunes à Médiouna, et d’une unité de santé mentale à Nouaceur.
Cet ambitieux programme cible une population de plus de 1,5 million de personnes, et vise particulièrement la prise en charge des femmes enceintes, des enfants âgés de moins de 5 ans, et des personnes souffrant de maladies chroniques. Il a aussi pour objectifs la promotion de la santé bucco-dentaire chez les jeunes, l’insertion sociale des malades souffrant de troubles mentaux, la réhabilitation psychomotrice chez les personnes en situation d’handicap, et la prise en charge de personnes souffrant de conduites addictives.
Source : http://www.leseco.ma
|
|
|
 La recherche biomédicale attend les décrets d’application
La recherche biomédicale attend les décrets d’application
Faute de décrets d’application, la loi sur la recherche biomédicale adoptée en mai 2015 n’est toujours pas effective. La communauté scientifique dénonce ce retard qui pénalise la recherche scientifique et surtout défavorise le Maroc au niveau international.
De l’avis des chercheurs, la recherche biomédicale concernant le médicament constitue une bonne opportunité pour le Maroc. Selon les dernières statistiques, en 2015 une enveloppe de 115 millions de dollars a été consacrée au financement des tests sur les humains et les animaux pour le développement de médicaments. On retiendra aussi que 20 000 essais sont en cours dans le monde. Mais, malheureusement, le Maroc n’a pas eu sa « part du gâteau ». Et ceci en raison du retard pris dans l’entrée en vigueur de la loi. Mais pas seulement. Selon le professeur HAKKOU, professeur chercheur et membre du comité d’éthique de Casablanca, « la loi devrait être mise à niveau car la procédure d’autorisation retenue est trop lente».
Le texte impose à tout projet de recherche scientifique de faire l’objet d’une demande d’autorisation délivrée par le ministère de la santé. Après instruction de la direction du médicament et de la pharmacie et avis de la direction de la réglementation, le dossier est transmis à la commission chargée de l’octroi des autorisations. Une procédure qui peut durer jusqu’à douze mois ou même plus. «Un délai trop long alors que dans les pays de l’UE et aux USA le délai varie respectivement de 45 à 27 jours!», souligne le professeur Hakkou. Le Maroc n’est donc pas compétitif. Preuve en est que plusieurs CRO (Contract Research Organism), des sociétés qui réalisent sous contrat des travaux de recherche pour le compte de laboratoires pharmaceutiques, viennent prospecter au Maroc mais ne signent aucun contrat. On retiendra également que les 4 ou 5 CRO nationales tournent au ralenti.
Aujourd’hui, le seul espoir pour changer cette donne, estime Farid Hakkou, «est l’activation de l’écosystème des essais cliniques dans le cadre du contrat programme signé il y a deux mois par l’AMIP. Il devrait favoriser un environnement propice à l’arrivée de CRO étrangères et dynamiser la recherche biomédicale au Maroc».
Source : www.lavieeco.com
|
|
|
 Antibiotiques : de nouveaux espoirs
Antibiotiques : de nouveaux espoirs
Lors de la séance penta-académique (agriculture, chirurgie dentaire, médecine, pharmacie, vétérinaire) portant sur « Antibiotiques, antibiorésistance et environnement : les raisons d’espérer », le praticien hospitalier, spécialiste de la résistance aux antibiotiques Thierry NAAS a rappelé que la lutte contre l’antibiorésistance est un immense défi. Mais « nous ne sommes pas encore dans une ère post-antibiotique », comme le dit l’Organisation mondiale de la santé (OMS). D’autant que « de nouveaux antibiotiques arrivent, avec des spectres beaucoup plus larges encore ».
Le désamour de l’industrie pharmaceutique pour la recherche sur les antibiothérapies jusqu’en 2011 s'est traduit par une explosion des résistances qui n’ont cessé de prendre de l’ampleur. Diverses stratégies se sont développées, comme le recyclage de « vieux » antibiotiques (fosfomycine, colistine, ou chloramphénicol), le recours à de nouvelles associations d’antibiotiques, ou encore la rationalisation de leur usage.
Désormais, le pipeline se remplit à nouveau. « Les antibiotiques qui sortent aujourd’hui sont ceux pour lesquels la recherche a commencé il y a une quinzaine d’années, ils répondent donc à la problématique de l’époque, à savoir la résistance du staphylocoque doré à la méticilline (SARM). Aujourd’hui, le problème repose sur les bactéries à gram négatif pour lesquels nous sommes face à une pénurie d’antibiotiques », note Thierry Naas.
Parmi les nouveaux antibiotiques disponibles, le spécialiste cite la telavancine (approuvée en Europe en septembre 2011), la ceftaroline (août 2012), la dalbamancine (février 2015), l’oritavancine (mars 2015). D’autres sont en phase III d’essais cliniques, comme deux nouvelles tétracyclines à spectre large agissant sur les bacilles à gram négatif : eravacycline et omadacycline.
« La molécule la plus intéressante est l’avibactam, commercialisée aux États-Unis et prochainement en Europe », ajoute Thierry NAAS. L’avibactam, en association avec la ceftazidime (Avicaz aux États-Unis, Zavicefta en Europe) ou la ceftaroline, permettrait de traiter 85 % des infections aux bactéries résistantes aux antibiotiques de dernier recours.
Source : Le Quotidien du pharmacien
|
|
|
 Cancer : la promesse des "biopsies liquides"
Cancer : la promesse des "biopsies liquides"
Il est désormais possible de détecter dans le sang la présence d’une maladie cancéreuse disséminée en recherchant des cellules tumorales circulantes (CTC) ou bien l’ADN tumoral provenant de la dégradation de ces cellules.
Des essais cliniques sont actuellement conduits sous l’égide de l’Institut Curie à Paris. "Un essai vise à déterminer si l’identification des CTC peut influer sur le choix du traitement dans le cancer du sein hormono-dépendant. Dans le cas où les CTC seraient indétectables, ou en deçà d’un certain seuil, l’oncologue pourrait opter pour un traitement moins agressif, comportant plus d’hormonothérapie et moins de chimiothérapie. Il s’agira ensuite de déterminer l’impact de cette prise de décision sur la survie des patientes et donc in fine d’évaluer l’utilité clinique de la recherche des CTC dans ce contexte", précise le Pr Jean-Yves Pierga, chef du département d’oncologie médicale à l’Institut Curie.
Ce spécialiste ajoute que l’autre enjeu des CTC et de l’ADN tumoral circulant, est d’en faire l’analyse pour "disposer d’informations sur la maladie métastatique à partir d’un simple échantillon de sang, sans avoir recours aux biopsies à l’aiguille". Autrement dit au prélèvement de tissu.
Source : http://www.sciencesetavenir.fr
|
|
|
 Des nanoparticules retrouvées dans l'alimentation industrielle
Des nanoparticules retrouvées dans l'alimentation industrielle
Une étude du Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE), commandée par l'ONG Agir pour l'environnement, a révélé que les nanoparticules se cachent dans notre nourriture. Après avoir analysé la composition de plusieurs produits de supermarchés, les chercheurs rapportent la présence systématique de nanoparticules malgré l'absence de signalisation claire sur l'étiquette.
Pour parvenir à ces résultats, des biscuits Napolitains LU, des chewing-gums Malabar, une blanquette de veau William Saurin, ainsi qu'un mélange d'épices pour guacamole de la marque Carrefour ont fait l'objet d'analyses.
Ainsi, les trois premiers aliments étudiés contiennent du dioxyde de titane, un colorant blanc étiqueté E171, tandis que le mélange d'épice pour guacamole contient du dioxyde de silice, un antiagglomérant surnommé E551. Ces deux substances peuvent être présentes sous deux formes, «nano» ou plus grosse. L'enjeu de l'étude était de définir quelle proportion de ces substances se trouve sous forme «nano» dans les aliments.
Résultat, le dioxyde de titane apparait sous forme «nano» à 12% dans les biscuits Napolitains de LU, à 2.5% dans les chewing-gums et à 16% dans les blanquettes de veau. Le dioxyde de silice, lui, est présent intégralement sous forme de nanoparticules dans le mélange d'épice. Si l'on prend les produits entiers, les nanoparticules représentent moins de 0.5% de la composition totale. «Logiquement, l'étiquetage devrait préciser NANO sur la boite mais pour le moment aucune loi n'oblige les industriels à le faire», explique Nicolas Feltin, responsable de la plate-forme de mesure CARMEN (pour Caractérisation Métrologique des NanoMatériaux).
Pour Magali Ringoot, coordinatrice des campagnes d'Agir pour l'Environnement, «cette enquête apporte la preuve qu'il y a défaillance dans l'information et la protection du consommateur. Les recommandations, aussi laxiste qu'elles soient, ne sont même pas appliquées!». L'ONG souhaite saisir les autorités afin de pousser les industriels à la transparence sur ce sujet, «il est urgent d'instaurer un moratoire, pour éviter qu'un nouveau scandale sanitaire comme celui de l'amiante ne se reproduise».
Car aujourd'hui, les effets sur la santé et l'environnement des nanoparticules sont très mal connus, faute d'études et de financements. Leur taille leur permet bien de traverser des barrières physiologiques, présageant de possibles dégâts physiologiques, pourtant aucune étude de permet de confirmer ces effets. Le Centre International de recherche sur le cancer (CIRC) a classé en 2006 le dioxyde de titane comme cancérigène possible lorsqu'il est inhalé sans faire mention du caractère nano ou pas de la particule.
Source : Santelefigaro.fr
|
|
|
|











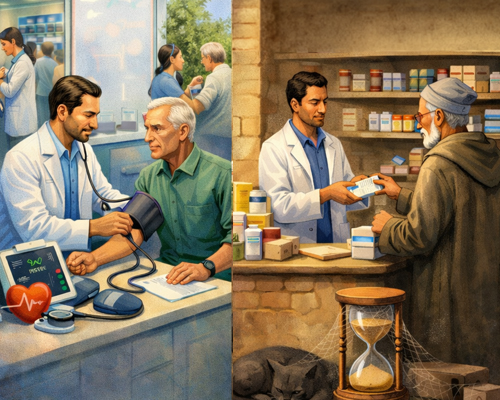
.jpg)
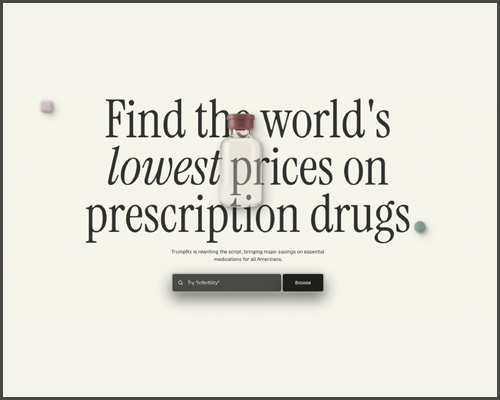
.jpg)