|
[ ÉDITORIAL ]
|
|
Il n’y a pas que les horaires !
Le rideau vient de tomber sur la 9ème édition des Journées Pharmaceutiques d’Agadir qui se sont tenues les 13, 14 et 15 mai dans une ambiance des plus confraternelles. Le thème retenu cette année par le comité scientifique est : « Notre pays évolue, où en est l’officine ? ».
Pour traiter les différentes thématiques prévues lors de cette manifestation, le comité scientifique a convié des universitaires et des experts qui ont, deux jours durant, fait le point, entre autres, sur l’évolution que connaît la profession à l’ère de l’internet et des techniques de l’information et de la communication (TIC).
Et même si un large pan de la population marocaine ne peut pas profiter pleinement du monde virtuel, les prémisses d’une révolution digitale s’affirment de jour en jour. Il n’y a qu’à voir l’engouement des marocains pour les réseaux sociaux pour s’en convaincre.
Cet intérêt pour les réseaux sociaux a été confirmé par l’enquête réalisée par l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) sur l’utilisation des marocains des TIC durant l’année 2015. D’après cette étude, publiée en 2016, sur les 17,8 millions de marocains connectés à Internet, 84,10% utilisent les réseaux sociaux et 38,3% utilisent la toile pour s’informer au sujet de leur santé. Quant aux mobinautes, 6.9% d’entre eux ont déjà téléchargé au moins une application mobile de santé. Cela nous amène à constater que les TIC prennent de plus en plus d’ampleur dans notre pays et à nous poser la question suivante : Qu’en est-il pour le pharmacien d’officine ?
Ce professionnel de santé qui est un gros utilisateur des TIC, a généralement une utilisation passive. Le plus souvent, il consomme de l’information et sa contribution en tant que fournisseur de contenu se cantonne à quelques notifications sur les réseaux sociaux. Malheureusement, les réseaux sociaux, qui permettent un échange facile et rapide de l’information, favorisent l’effet d'annonce et le buzz sur l’archivage. Les nouvelles notifications masquent les anciennes ce qui les rend difficilement trouvables. Ceci, n’est pas le cas des sites web structurés où un bon archivage permet généralement de retrouver facilement toutes les publications qui y figurent.
Par ailleurs et en dehors de quelques exceptions, peu de pharmaciens ont mis en ligne un site web propre à leur pharmacie avec comme objectif de promouvoir leurs activités et fournir un contenu rédactionnel de qualité à leurs patients. Les pharmaciens d’officine ont aussi la possibilité de créer une communauté de patients avec qui ils pourront garder un contact permanant, ne serait ce que pour les inciter à améliorer leur couverture vaccinale ou leur hygiène de vie.
Quant au conseil de l’ordre, il ne peut faire l’économie d’accélérer la mise en ligne de son projet de portail. Grâce à cet outil, il pourrait partager avec les Internautes des publications pour faire connaître la profession et l’actualité des instances. Ce portail permettrait aux ressortissants des conseils de payer une cotisation, d’imprimer une facture ou un historique à distance. Il peut également leur permettre de participer à un sondage ou à une élection en ligne.
Via ce portail très attendu, le conseil peut également fournir des informations au sujet des ruptures de stock où des retraits de médicaments, et peut même aider les pharmaciens à évaluer la qualité de leurs pratiques et à se former à distance.
Pour que notre conseil puisse s’atteler à un aussi grand chantier, il doit retrouver sa sérénité. Or aujourd’hui, les pharmaciens passent le plus clair de leur temps à se chamailler au sujet des horaires et des tours de garde. Ces deux sujets de discorde, qu’il faut évidemment résoudre dans les plus brefs délais, risquent néanmoins d’éclipser d’autres problématiques, plus insidieuses et dont l’issue sera décisive pour l’avenir et la viabilité de toute la profession.
Abderrahim DERRAJI
|
|
|
Revue de presse

|
 L’ouverture des capitaux des cliniques au privé n’a pas eu les effets escomptés
L’ouverture des capitaux des cliniques au privé n’a pas eu les effets escomptés
À ce jour, l’application de la loi 113-13 autorisant l'ouverture du capital des cliniques privées à des investisseurs non médecins n’a pas tenu ses promesses. Selon Aziz Rhali, vice-coordinateur du Collectif pour le droit à la santé au Maroc, « il n’y a pas eu d’investissements, exception faite de certaines acquisitions de cliniques. Saham- Santé semble être l’investisseur le plus en vue puisqu’il a mis cinq cliniques dans son escarcelle. Il y a aussi le centre de soins « Healthcare City » lancé par des Emiratis et qui sera opérationnel en 2017 et deux projets de cliniques des groupe Ben Laden et Holmarcom qui devront voir le jour prochainement ». Et de préciser que «L’ensemble de ces investissements se concentre dans les villes de Casablanca, Mohammedia, Rabat et Marrakech » et que le seul axe Casablanca-Rabat accapare 30% des 371 cliniques existantes, soit 35% de la capacité hospitalière nationale estimée à 14.560 lits.
« El Houssaine LOUARDI a toujours prétendu que cette loi allait permettre de drainer l’investissement vers les petites localités et les zones éloignées. Mais, aujourd’hui, la réalité est toute autre. Les investisseurs ciblent les grandes villes où ils peuvent amortir leurs investissements de manière suffisamment rapide. Jamais aucun opérateur privé n’osera investir des millions de DH à Bouarfa ou à Figuig. Ce sont les grandes clinques de Casablanca, Rabat et Marrakech qui sont ciblées en priorité», nous a indiqué Aziz Rhali.
Dr. Badreddine Dassouli, président du Syndicat national des médecins du secteur libéral (SNML), a affirmé à son tour que « la ruée des investisseurs n’a pas eu lieu. Ces derniers jouent de prudence. L’expérience de la clinique Ghandi en a découragé plus d’un, puisque les prévisions escomptées ne se sont pas réalisées et, du coup, les investisseurs patientent tout en avançant à petits pas ». Et d’ajouter : « Aujourd’hui, ils manœuvrent dans les coulisses pour orienter la demande de soins de santé vers le secteur privé, notamment via les sociétés d’assurance qui dirigent ainsi leurs clients vers certaines cliniques et pas d’autres».
Source : libe.ma
|
|
|
 Diagnostic de l’asthme : on est passé du sous-diagnostic au sur-diagnostic
Diagnostic de l’asthme : on est passé du sous-diagnostic au sur-diagnostic
À l’occasion de la journée mondiale de l'asthme célébrée le 3 mai 2016, deux articles ont révélé que dans cette pathologie infantile, on serait passé du risque de sous-diagnostic à celui de sur-diagnostic.
Le premier article rapporte les résultats d'une étude clinique rétrospective menée aux Pays-Bas dans des centres de soins primaires. Les dossiers de 652 enfants, âgés de 6 à 18 ans, codés « asthme » (n=546), ou ayant fait des exacerbations ou pris des médicaments inhalés (n=106), ont été revus pour apprécier la fiabilité de leur « étiquetage».
Le diagnostic d'asthme a été considéré comme excessif chez 53,3 % des enfants (349 sur 652). Bien que codés « asthme », ces enfants n'avaient pas présenté d'exacerbation et ils avaient utilisé moins de 3 flacons de bêta-2 sympathicomimétiques en une année. De plus, 5 avaient une spirométrie normale. A l'opposé, 16,1 % des enfants avaient un asthme confirmé par une spirométrie et 23,1 % un asthme probable selon les données de la clinique et les traitements.
Seul un enfant de la cohorte sur 6 a passé des épreuves fonctionnelles respiratoires [EFR], alors qu'il est possible et conseillé de faire une spirométrie à partir de l'âge de 6 ans. Les auteurs concluent ainsi que le diagnostic d'asthme est fréquemment porté par excès chez l'enfant, en soins primaires, aux Pays-Bas, ce qui induit des traitements inutiles, alourdit le fardeau de la maladie et altère la qualité de vie, et qu'il s'appuie rarement sur des EFR.
Le second article, à paraître dans un prochain numéro des Archives of Disease in Childhood, exprime l'opinion argumentée de deux pneumo-pédiatres anglais (2). Le diagnostic d'asthme infantile serait aussi porté par excès au Royaume-Uni, particulièrement celui de « toux équivalent d'asthme » (en anglais, cough variant asthma). Ce qui inquiète les deux spécialistes se sont, au-delà des coûts, les effets secondaires auxquels sont exposés les enfants inutilement traités avec des corticoïdes inhalés : ralentissement de la croissance, augmentation des infections respiratoires, etc.). D'après eux « le diagnostic d'asthme s'est banalisé, les inhalateurs sont délivrés sans bonne raison et sont presque devenus un accessoire à la mode. Il en résulte que l'asthme, une maladie létale si elle n'est pas correctement traitée, est prise à la légère. »
Source : JIM
|
|
|
 Les prélèvements sanguins mieux conservés par la soie
Les prélèvements sanguins mieux conservés par la soie
Réaliser un diagnostic à partir d'un prélèvement sanguin peut se révéler très complexe dans les zones reculées. Jusqu'à 67% des erreurs sont issues d'une perte de qualité de l'échantillon provoquée par les nombreuses heures de transports jusqu'aux centres d'analyses. Pour pallier à ces dégâts, des chercheurs américains ont développé un moyen de conserver l'intégrité des prélèvements. Ils les ont plongés dans une matrice de protéine de soie. Leurs résultats, publiés cette semaine dans le journal de l'Académie américaine des sciences (PNAS), révèlent une grande efficacité.
«Les biomarqueurs sont restés intact après avoir été conservé pendant 84 jours à 45°C. C'est beaucoup mieux que les approches traditionnelles, surtout à de hautes températures comme celles atteintes durant l'été», racontent les auteurs. «Cette approche pourrait faciliter le dépistage et la surveillance des maladies dans les populations mal desservies mais également permettre des essais pharmacologiques à distance», poursuivent-ils.
Le protocole est le suivant: la protéine de la soie, la fibroïne, est extraite de cocons de vers à soie. Les chercheurs la purifient et la mélangent avec le sang. Elle forme alors un film légèrement solide de quelques centimètres qui encapsule le fluide et peut-être conservé à 22°C comme à 45°C. Pour récupérer l'échantillon intact, il suffit de dissoudre la fibroïne dans de l'eau. Ces phénomènes ne sont pas spécifiques à la soie mais celle-ci présente la meilleure robustesse tout en restant très facile à manier.
L'utilisation de cette protéine permet une meilleure précision que les techniques traditionnelles. La conservation du sang à -20°C était jusqu'à présent la plus efficace. Cependant, elle présente des limites. Par exemple, la Protéine C réactive, biomarqueur de l'inflammation est endommagé lors du dégel (20% de perte) tandis qu'elle reste parfaitement intacte sous la soie.
Soiurce : www.sante-lefigaro.fr
|
|
|
 Pfizer arrête l’usage de ses produits pour les injections létales aux Etats-Unis
Pfizer arrête l’usage de ses produits pour les injections létales aux Etats-Unis
Pfizer, le premier groupe pharmaceutique américain, a annoncé vendredi soir avoir pris des mesures afin de s'assurer qu'aucun de ses produits ne soit utilisé dans des injections létales.
Cette mesure signe la fermeture de la dernière source d'approvisionnement sur le marché pour les substances utilisées dans les exécutions. Une vingtaine de groupes européens et américains ont en effet déjà pris des mesures similaires, selon le New York Times.
Dans la liste des produits commercialisés par Pfizer et visés pour l'injection létale figure le puissant anesthésique propofol, qui avait causé la mort du chanteur Michael Jackson. Les autres substances faisant l'objet de restrictions sont le bromure de pancuronium, le chlorure de potassium, l'idazolam, l'hydromorphone, le rocuronium et le vécuronium.
La vente de ces sept produits sera limitée à un groupe défini de grossistes, de distributeurs et d'acheteurs, à la condition expresse qu'ils ne les revendent pas à des services pénitentiaires pour un usage dans des injections létales, précise le groupe.
Source : les Echos
|
|
|
 Les pharmaciens québécois sont en colère
Les pharmaciens québécois sont en colère
Les 2 048 pharmaciens Québec sont en colère contre leur gouvernement. La raison? Les promesses non tenues par les pouvoirs publics qui s’étaient engagés à compenser la participation consentie par les pharmaciens à l’effort budgétaire (400 millions de dollars canadiens sur trois ans, soit 274 millions d'euros) par un déplafonnement de leurs remises sur le générique.
Le gouvernement revient désormais sur cet engagement et n'envisage de lever le plafonnement que dans neuf mois. Cette décision suscite la grogne de l’Association des pharmaciens propriétaires du Québec (AQPP) qui estime le manque à gagner pour la profession à 82 millions de dollars canadiens (56 millions d'euros). Si le ministre de la Santé s’obstine à refuser le dialogue, les pharmaciens prévoient « des moyens d’action » dont ils dévoileront la teneur au cours de la semaine prochaine.
Le président de l’AQPP, Jean Thiffault, affirme que les pharmaciens sont traités comme des professionnels « de seconde zone » alors qu’ils devraient être mieux « utilisés », et être autorisés à vacciner et à « déprescrire » des médicaments chez certains patients polymédiqués. Ces revendications risquent d’envenimer les relations avec les médecins qui refusent « de transférer leurs patients aux pharmaciens ». En vertu de la loi 41 qui permet aux officinaux de pratiquer des actes médicaux gratuits, ils se sont en effet vu confier, dans certaines régions, le suivi des patients sous anticoagulants moyennant une rémunération de 16 dollars par mois (11 euros), prise en charge, en partie, par les assurances.
Source : http://www.lequotidiendupharmacien.fr
|
|
|
|










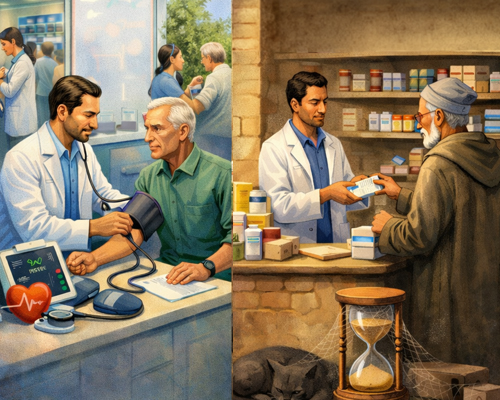
.jpg)
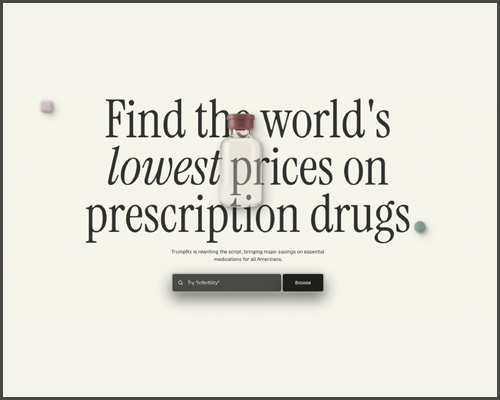
.jpg)