Revue de presse

|
 Maroc : 128 nouveaux médicaments sont désormais remboursables
Maroc : 128 nouveaux médicaments sont désormais remboursables
L’Agence nationale de l’assurance maladie a intégré 128 médicaments, dont 66 génériques, au panier des produits pharmaceutiques remboursables. Ces médicaments sont utilisés dans le traitement des affections de longue durée telles que la schizophrénie, la dépression, l’épilepsie, les maladies de Parkinson et d’Alzheimer… Au total, 3.576 médicaments sont remboursables au titre de l’AMO, dont 2.103 génériques. Soit 60% des médicaments commercialisés.
http://www.leconomiste.com
|
|
|
 Diabète : Sanofi dépose une demande d’approbation aux USA
Diabète : Sanofi dépose une demande d’approbation aux USA
Le groupe pharmaceutique Sanofi vient de déposer une demande d’approbation d’un nouveau médicament (New Drug Application, NDA) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour l’association à dose fixe expérimentale d’insuline glargine 100 unités/ml et de lixisénatide qui, si elle est approuvée, permettrait de traiter les adultes atteints de diabète de type 2 en une injection par jour.
« Le dépôt de cette demande d’approbation d’un nouveau médicament est une étape importante des efforts que déploie Sanofi pour développer sa franchise Insuline », a déclaré Pierre Chancel, Senior Vice-Président et Responsable de la Division Diabète Globale de Sanofi.
Sanofi a utilisé un droit d’accès à un examen prioritaire (priority review voucher, PRV) pour cette soumission afin que le dossier puisse bénéficier d’un examen accéléré de 6 mois, si celui-ci est accepté par la FDA, au lieu des 10 mois réglementaires.
Source : Sanofi Diabète
|
|
|
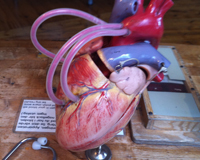 La mise en place de plusieurs endoprothèses ne lèse pas le cœur
La mise en place de plusieurs endoprothèses ne lèse pas le cœur
Une étude britannique a révélé qu’une revascularisation étendue, portant sur toutes les artères rétrécies, est tout aussi sûre que la réparation exclusive de l’artère à l’origine de la crise cardiaque. Cela n’occasionne pas davantage de lésions au niveau du cœur.
Les scientifiques de l’Université de Leicester ont recruté dans leur étude 203 patients victimes d’une crise cardiaque. Certains d’entre eux (105) ont été randomisés pour être opérés de l’artère obstruée uniquement tandis que les autres (98 participants) ont subi une revascularisation étendue, portant sur toutes les artères rétrécies. Après le traitement, tous les participants ont effectué des examens IRM.
Les résultats ont montré que les patients dont toutes les artères avaient été traitées présentaient plus souvent plusieurs régions montrant des lésions cardiaques (22 % contre 11 % chez ceux dont une seule artère avait été traitée). Au total, le pourcentage de myocarde lésé était cependant tout aussi élevé dans les deux groupes (12,6 contre 13,5 %). La fonction cardiaque dans les deux groupes était semblable : à la fois immédiatement après le traitement et neuf mois plus tard.
Source : Journal of the American College of Cardiology
|
|
|
 Le troisième patient porteur d'un cœur artificiel Carmat est décédé
Le troisième patient porteur d'un cœur artificiel Carmat est décédé
Le troisième patient implanté d'un cœur artificiel Carmat est décédé vendredi de «mort subite par arrêt respiratoire au cours d'une insuffisance rénale chronique», a indiqué la société Carmat dans un communiqué mardi.
Ce monsieur, âgé de 74 ans, avait été opéré le 8 avril, soit il y a plus de huit mois. Il avait pu quitter l'hôpital et rentrer chez lui fin août. Souffrant d'insuffisance rénale préexistante à l'implantation de sa prothèse, il faisait de fréquents passages à l'hôpital.
Le défunt était le troisième volontaire d'une série de quatre dans cette première phase d'essai clinique visant à vérifier la sécurité du premier cœur artificiel total testé sur l'homme. Avant lui, le premier patient, Claude Dany, avait survécu 74 jours avec la prothèse, et le deuxième, dont l'identité a été gardée secrète, 9 mois. Tous souffraient d'insuffisance cardiaque en phase terminale qui leur laissait très peu d'espérance de vie.
Carmat écrit encore que «les analyses réalisées n'ont pas montré d'implication de la prothèse dans le décès du patient». L'essai se poursuit donc, l'objectif minimum fixé pour juger de la réussite du test étant 30 jours de survie avec la prothèse, un seuil que tous les patients ont donc atteint. Mais tout n'a pas toujours été parfait: les deux premiers décès avaient été causés par une «micro-fuite de la zone sang vers le liquide d'actionnement de la prothèse», ayant engendré une «perturbation de l'électronique de pilotage des moteurs» du coeur artificiel, a analysé Carmat ces derniers mois.
En revanche, la prothèse du troisième patient était en parfait état de marche et a fonctionné «jusqu'à la fin»: elle a été arrêtée par les médecins après le décès du porteur, a précisé Marcello Conviti, le directeur général de la société.
Carmat a obtenu fin novembre les autorisations nécessaires pour greffer en France un quatrième et dernier patient dans le cadre de cette étude de faisabilité. Celle-ci est le prélude obligatoire d'une étude plus large, devant porter sur une vingtaine de patients dans dix centres d'implantation en Europe.
|
|
|
 Un logiciel détecteur de mensonges
Un logiciel détecteur de mensonges
Quatre chercheurs de l’université du Michigan, aux Etats-Unis, ont mis au point un prototype censé permettre, à terme, de déterminer si quelqu’un ment ou dit la vérité, simplement en scrutant son élocution, sa gestuelle et ses mouvements faciaux. Le programme relève de la technique du machine learning, à savoir qu’il apprend en analysant un jeu de données et améliore son efficacité au fur et à mesure qu’il analyse de nouvelles données.
En l’occurrence, ce logiciel a été entraîné avec 120 vidéos d’authentiques procès filmés dont on connaît le verdict (et qui ne sont pas des erreurs judiciaires !) et pour lesquels on sait qui a menti et qui a dit la vérité au cours de l’audience. L’intérêt du procédé ? Eviter d’avoir à recréer en laboratoire une fausse situation de procès où un interlocuteur ferait semblant de mentir. Les chercheurs estiment que dans ce type de contexte, les "menteurs" jouent trop mal le mensonge car il manque la motivation inhérente au procès : sauver sa peau !
Les vidéos utilisées montrent à la fois des suspects et des témoins et, dans la moitié des cas choisis, les personnes mentaient. Les chercheurs ont intégralement retranscrit les audiences, en y incluant les hésitations et les onomatopées (les "euh" et "bah"), afin de déterminer comment s’exprime un menteur, quels sont ses tics. Idem pour les gestuelles, réparties en neuf catégories de mouvements de tête, d’yeux, de bouche, de mains et de sourcils, chacune correspondant à un niveau de mensonge.
Ce sont tous ces paramètres qui ont été intégrés au logiciel. Il en ressort que fixer son interlocuteur est un signe de mensonge probable (70 % des menteurs le faisaient, contre 60 % de ceux qui disaient la vérité). Agiter les mains également (40 % contre 25 %), comme se tordre les traits du visage (30 % contre 10 %).
Les premiers résultats sont prometteurs puisque l’équipe assure avoir obtenu des taux d’efficacité du dispositif de 75 %. La recherche n’est cependant pas terminée puisqu’elle devrait prochainement intégrer d’autres paramètres comme le rythme cardiaque ou celui de la respiration, des données là aussi captées à distance, par imagerie thermique.
Source : http://www.sciencesetavenir.fr
|
|
|
|









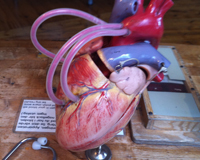


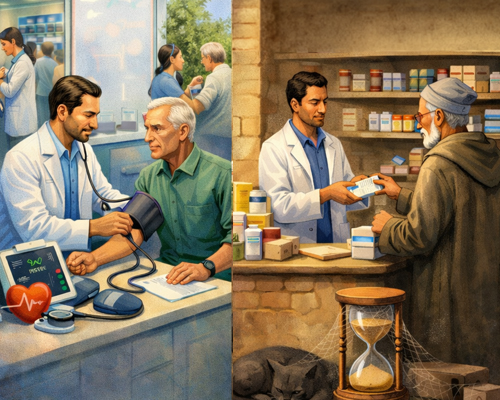
.jpg)
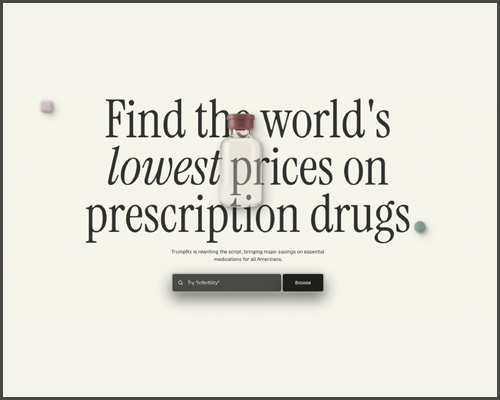
.jpg)